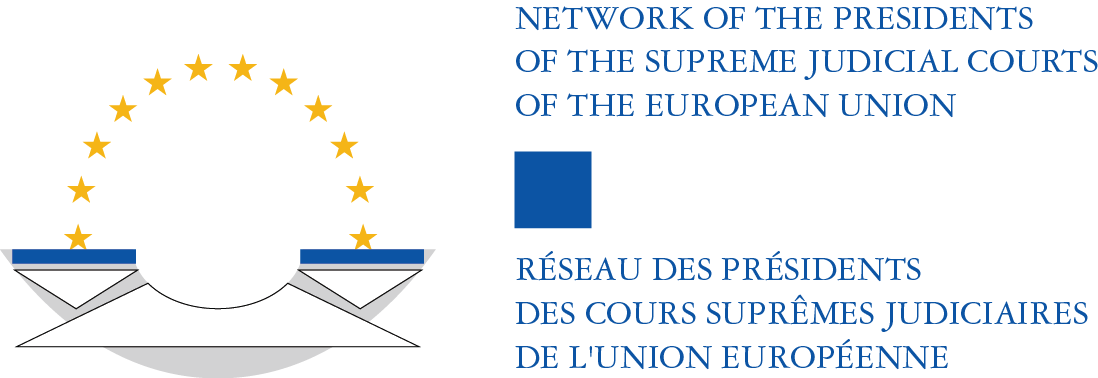Küsimustiku saatmine
| Dokumendiregister | Riigikohus |
| Viit | 7-8/24-159-1 |
| Registreeritud | 15.03.2024 |
| Sünkroonitud | 29.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 Juhtimine |
| Sari | 7-8 Riigikohtu esimehe kirjavahetus välisriikide kõrgemate kohtute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega |
| Toimik | 7-8/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
| Saabumis/saatmisviis | Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
| Vastutaja | Karin Leichter-Tammisto (Riigikohus, Juhtkond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Failid
From: <[email protected]>
Sent: Thu, 14 Mar 2024 14:16:55 +0000
To: <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <DonalO'[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>
Cc: 'Hascher' <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]>
Subject: Conference of the Network (3-5 October 2024, Athens) - Conférence du Réseau (3-5 octobre 2024, Athènes)
Dear President,
At the kind invitation of Ms Ioanna Klapa-Christodoulea, President of the Supreme Court of Greece, the next Conference of the Network will be held on 3-5 October 2024 in Athens. The Conference is dedicated to the topics of “Impact of European Law on National Law” and “Attractiveness of the Judiciary”. Please kindly find attached the preparatory questionnaires of the Conference.
The questionnaire on “Impact of European Law on National Law” was established by Mr Christophe Soulard, First President of the French Cour de cassation. To facilitate answering the questionnaire the Cour de cassation has already provided their responses which we also enclose.
The questionnaire on “Attractiveness of the Judiciary” was established by Mr Petr Angyalossy, President of the Supreme Court of the Czech Republic, Ms Danguolė Bublienė, President of the Supreme Court of Lithuania and Mr Miodrag Đorđević, President of the Supreme Court of Slovenia. The questionnaire consists of two parts – the first part focuses on the attractiveness of the judiciary from the perspective of judges and the second part from the perspective of court personnel.
With a view to streamlining the preparation of the documents for the Conference, it would be very helpful if the answers to the enclosed questionnaires could be returned to the Secretariat of the Network ([email protected]) by the end of May 2024. Sending your replies to the questionnaires by this date would be very helpful for the preparation of Introductory Reports to be established thereafter by First President Soulard, President Angyalossy, President Bublienė and President Đorđević.
Practical information concerning the Athens Conference will soon follow.
Yours sincerely,
Madame, Monsieur le premier président,
A l’aimable invitation de Mme Ioanna Klapa-Christodoulea, présidente de la Cour suprême de Grèce, la prochaine conférence du Réseau se tiendra du 3 au 5 octobre 2024 à Athènes. La conférence est consacrée aux thèmes de « L’effet du droit européen sur le droit national » et « L’attractivité du système judiciaire ». Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les questionnaires préparatoires de la conférence.
Le questionnaire sur « L’effet du droit européen sur le droit national » a été établi par M. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation française. Pour faciliter la réponse au questionnaire, la Cour de cassation a déjà fourni ses réponses que nous joignons également.
Le questionnaire sur « L’attractivité du système judiciaire » a été établi par M. Petr Angyalossy, président de la Cour suprême de la République tchèque, Mme Danguolė Bublienė, présidente de la Cour suprême de Lituanie et M. Miodrag Đorđević, président de le Cour suprême de Slovénie. Le questionnaire se compose de deux parties – la première partie porte sur l’attractivité du système judiciaire du point de vue des juges et la seconde du point de vue du personnel des cours.
En vue de rationaliser la préparation des documents pour la conférence, nous vous serions très obligés de bien vouloir adresser les réponses aux questionnaires, qui sont joints à la présente communication, au secrétariat du Réseau ([email protected]) pour la fin mai 2024. La remise de vos réponses à cette date sera très utile pour la préparation ultérieure des rapports introductifs par M. le premier président Soulard, M. le président Angyalossy, Mme la présidente Bublienė et M. le président Đorđević.
Des informations pratiques concernant la conférence d’Athènes suivront bientôt.
Veuillez croire, je vous prie, Madame, Monsieur le premier président, à l’expression de notre haute considération.
Liis Lindström
Réseau des Présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne
Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union
5 quai de l’Horloge
75055 Paris cedex 01 TSA 79201
From: [email protected] <[email protected]>
Sent: Friday, January 26, 2024 4:07 PM
Subject: Conference of the Network (3-5 October 2024, Athens) - Conférence du Réseau (3-5 octobre 2024, Athènes)
Dear President,
We would like to inform you that, at the kind invitation of Ms Ioanna Klapa-Christodoulea, President of the Supreme Court of Greece, the next Conference of the Network will be held on 3-5 October 2024 in Athens. The Conference will be dedicated to the following topics: “Impact of European Law on National Law” and “Attractiveness of the Judiciary”. The preliminary programme of the event is as follows:
Thursday, 3 October 2024
Arrival of Participants
Afternoon – Meeting of the Board
Evening – Welcome dinner
Friday, 4 October 2024
Day – Conference of the Network (full day)
Evening – Gala Dinner
Saturday, 5 October 2024
Social Programme
Departure of Participants
Further information will follow closer to the event. Please do not hesitate to contact the Secretariat of the Network should you have any questions.
Yours sincerely,
Madame, Monsieur le premier président,
Nous vous informons qu’à l’aimable invitation de Mme Ioanna Klapa-Christodoulea, présidente de la Cour suprême de Grèce, la prochaine conférence du Réseau se tiendra du 3 au 5 octobre 2024 à Athènes. La conférence sera consacrée aux thèmes suivants : « L’Impact du droit européen sur le droit national » et « L’attractivité du système judiciaire ». Le programme préliminaire de l’événement est le suivant :
Jeudi 3 octobre 2024
Arrivée des participants
Après-midi – réunion du conseil d’administration
Soirée – dîner de bienvenue
Vendredi 4 octobre 2024
Jour – conférence du Réseau (journée entière)
Soirée – dîner de gala
Samedi 5 octobre 2024
Programme social
Départ des participants
De plus amples informations seront communiquées à l’approche de l’événement. Nous vous prions de bien vouloir contacter le secrétariat du Réseau pour toute question.
Veuillez croire, je vous prie, Madame, Monsieur le premier président, à l’expression de notre haute considération.
Liis Lindström
Réseau des Présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne
Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union
5 quai de l’Horloge
75055 Paris cedex 01 TSA 79201
NETWORK OF THE PRESIDENTS OF THE SUPREME JUDICIAL COURTS
OF THE EUROPEAN UNION
CONFERENCE OF THE NETWORK
3–4 OCTOBER 2024
ATHENS, GREECE
Questionnaire
Topic: Impact of European Law on National Law
Written by Mr Christophe Soulard, First President of the French Cour de cassation
In the following questionnaire European law should be understood as encompassing the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and European Union law. Indeed, these are “two branches of law which, although distinct, influence each other and form two aspects of the same legal reality: the reality of a law integrated into the national legal order”1.
These previously much-criticised rights have now been incorporated within the legal orders of the Member States of the European Union. It is therefore relevant to refer to the Europeanisation of law. In academic writing, the concept of Europeanisation has three main dimensions:
1) “A vertical movement from the top (the European institutions) to the bottom (the Member States), through which European Union law exerts an influence on domestic law;
2) An inverse vertical movement from the bottom (the Member States) to the top (the European institutions), by means of transfers of powers to the European Union or transfers of prerogatives to the European institutions (however, the fact that the adoption of European rules, whether primary law or secondary law, results from negotiations which, on occasion, may be more advantageous for one State than another, does not prevent it from being seen, generally speaking, as a form of Europeanisation);
3) A horizontal movement from one Member State to another. In other words, the convergence of national laws is the result of a transfer or an imitation: one Member State can decide to adopt a rule that was issued in another Member State without it being imposed from above by the institutions of the European Union” 2.
This multifactorial Europeanisation bears witness to the impact of European law on the positive law of the Member States and modulates the organisation of the judicial institution. This observation is reinforced by a process of progressive expansion and acceptance of fundamental rights in domestic legal systems (“fundamentalisation”), notably through the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Therefore, in order to structure this questionnaire and our future thinking, allow me to refer to Professor Mireille Delmas-Marty who, in her work on La grande complexité du monde juridique3 (the great complexity of the legal world), refers to the various forms of legal integration in terms of the “globalisation of law”4, namely “normative, jurisdictional and institutional, which are developing simultaneously on a regional and global scale”. This questionnaire will provide an opportunity to examine the impact of European law on the positive law of the Member States, particularly from (I) the institutional, (II) the jurisdictional and (III) the normative standpoints. These three parts will be preceded by preliminary questions that are general in nature, and followed by examples relating to common themes.
To help you analyse the questions and draft your answers, you will find some short answers relating to France in the footnotes, and all the detailed answers from the French Cour de cassation in the appendix to the questionnaire.
Preliminary questions
(a) Can you explain how the provisions of European Union primary law and the international treaties of the Council of Europe such as the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are positioned in your country's domestic legal order? Do these provisions have directly binding legal force (monist tradition)? Do they have to be transposed into national law (dualist tradition)? Alternatively, do you have a mixed system? Are there any debates on this subject?
(b) What is the position of European law in relation to international law in your country (is a distinction made)?
(c) Similarly, how are the provisions of European law placed within the hierarchy of norms of your domestic legal system? Please briefly describe your country's case law on the construction of this hierarchy of norms and on the principle of primacy of European Union law.
I§ Institutional impact
What is the impact of European law on the institutional organisation of supreme courts?
Question 1. (a) Has European law and the case law of the supranational courts led to reforms in your institutions?
Please provide a few practical examples highlighting the institutional impact of European law on your court or jurisdiction (following a ruling by the CJEU or the ECHR, for example).
(b) What recent justice reforms have been driven by Europe in your country?
Question 2. Has your country created a legal channel and/or a specialised body for the recognition in domestic law of the effects of judgments handed down by the European Court of Human Rights? If so, is it linked to your Court?
Question 3. Has your court, and more generally the justice system in your country, benefited from a European programme? If yes, what was its impact?
Question 4. What methods are used and what measures have been put in place within your Court to enable the judges and legal practitioners of your court to follow the case law of the CJEU and the ECHR with a view to improving the reception and implementation of European law? Do the members of your court receive training in European law?
II§ Jurisdictional impact
How has European law changed the role or function of the judge and how has it inserted itself into the case law of the supreme judicial courts?
Question 5. In what way do you consider that European law has modified your role or position as a judge?
Question 6. As a judge of ordinary law, of European Union law and primary judge of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, do you regularly and explicitly refer in your judgments to provisions of European law, general principles of law and decisions handed down by the CJEU and the ECHR? If that is the case, can you briefly outline the history of your supreme court's acceptance of these “rights originating from elsewhere”5, in particular the rulings that marked this acceptance?
For what purposes are CJEU and ECHR rulings referred to in the decisions of your courts (whether it be vis-à-vis internal/external stakeholders or to engage in judicial dialogue)?
Question 7. (a) Discussion between judges is essential “at a European level, where not only do the national legal orders and the Community legal order coexist, but the national legal orders also coexist with the legal order resulting from the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”6. Does your court regularly refer questions to the CJEU for a preliminary ruling (under Article 267 TFEU) or request advisory opinions from the ECHR (Protocol No. 16)?
(b) The national court decides, on the basis of considerations of procedural utility and cost saving, at what stage of the proceedings to refer a question to the CJEU for a preliminary ruling (under Article 267 TFEU (CJEC, Judgment of 10 March 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association and Others, Joined cases 36 and 71/80, ECLI:EU:C:1981:62 X., paragraphs 7 to 9; CJEC, Judgment of 7 January 2004, Case C-60/02, ECLI:EU:C:2004:10, X., paragraph 28)). The request for an advisory opinion (Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) follows the same logic.
Therefore, in practice, how do you decide whether to use these mechanisms to refer a question to the CJEU for a preliminary ruling or to request an advisory opinion from the ECHR? Do you tend to use them at the initiative of the parties or at your own discretion?
Question 8. (a) Have you developed a template, a standard form or any other useful instrument to help judges make a reference for a preliminary ruling to the CJEU, following the recommendations of the CJEU (2019/C 380/01), in order to avoid a request for clarification (under Article 101 of the Rules of Procedure of the CJEU) or the question being declared manifestly inadmissible because it does not comply with the minimum requirements imposed by the CJEU (requirements laid down in Article 94 of the aforementioned Rules), or an advisory opinion to the ECHR?
(b) When you make a reference for a preliminary ruling or submit a request for an advisory opinion to a supranational court, do you put forward your court's position on the debated issue? Do you feel that you have an influence on the CJEU case law or the ECHR case law?
Question 9. (a) Under Protocol No. 16 to the Convention, seven advisory opinions have been delivered by the ECHR (at the request of France, Armenia, Lithuania, Finland and Belgium) and two requests for an advisory opinion have been rejected (the requests made by Estonia and Slovakia). Have you already used this mechanism? If so, for which case(s) and if not, how would you explain the lack of use of this mechanism?
(b) Have you ever had occasion to refer to opinions delivered by the ECHR in your decisions, even though the request for an opinion had been made by another Member State? If so, can you give details of the judgment(s) in question?
Question 10. (a) The CJEU and the ECHR provide substantial reasons for their decisions. In the light of European requirements, have you had to modify your practice of giving reasons for your judgments? If the answer is yes, can you indicate whether this reform was undertaken following an adverse ruling, or because of European law or the practices of neighbouring supreme or supranational courts? Has the European courts' drafting methodology influenced the way you give reasons for your judgments (for example, making more references to your own legal precedents or to comparative law)?
(b) Do you think that European law has changed the notion of case law in continental legal systems?
Question 11. Insofar as possible, can you refer to decisions handed down by your court
(a) Explicitly or implicitly taking into account the national margin of appreciation provided for by European law;
(b) Adopting the interpretation of the CJEU/ECHR and setting aside national case law.
Taking this further. The impact of European law: dialogue between judges and the extraterritorial influence of European law
Question 12. As mentioned in my introductory remarks, Europeanisation is also marked by a horizontal movement from one Member State to another. The use of case law from other Member States in judgments is a perfect illustration of this movement. Does your court give an important place to comparative law in its reasoning?
Question 13. Are you aware of a ruling of the ECHR or the CJEU, or one of your own decisions handed down in application of European law, that has been used by a supreme court of a third State?
III§ Normative impact
How has European law affected rules of domestic law in the Member States?
Question 14. Europeanisation is characterised by a vertical movement from top to bottom and a vertical movement from bottom to top. Therefore, two questions arise:
(a) Can you estimate, on the basis of the information available to you, the number of national provisions having a European origin?
(b) What ties does the legislative power have with the European institutions? Furthermore, does your country's legislature cooperate actively with the European institutions in the process of drafting European standards?
Question 15. In terms of European Union law, does your country fully transpose all European directives and more generally bring its legislation into line with all European standards? In this sense, are you aware of any infringement proceedings brought by the European Commission against your State in recent years for breach of European Union law by a judicial authority (under Article 258 TFEU) or for failure to fulfil its obligation to adopt measures transposing a directive (under Article 260(3) TFEU)?
Question 16. When your court applies European secondary legislation, do you directly cite the directive (instead of the transposing law)? Do you refer to the preparatory works behind the European provisions in the reasoning of your decisions (i.e. using a teleological interpretation)?
Question 17. In the light of the information at your disposal, can you indicate which major rulings handed down by the ECHR have had a normative/jurisprudential impact on the organisation or operating of your legal system7 (idea of a tripartite dialogue between the supranational judge, the national judge and the legislator)?
Insofar as possible, please provide examples of judgments handed down by your court in response to a European judgment that has led to legislative reform (adverse ruling, rulings validating your legislative developments, rulings handed down against other Member States that have had an impact on you, etc.).
Question 18. The impact of European law is also reflected in the idea of the equivalence of European and national provisions, particularly constitutional provisions. It follows that the ECHR, when interpreting the applicant's obligation to raise, in substance, a complaint alleging a violation of the Convention, has accepted that applicants may rely on equivalent provisions of domestic law (Guberina v Croatia, 22 March 2016, no. 23682/13) 8. This issue also arises from the standpoint of the national court. When reviewing the conformity of a national act transposing European Union law with a constitutional provision that has its equivalent in European Union law, do the higher courts in your country rely on the constitutional provision or the European provision? In other words, do they apply the theory of equivalence when reviewing conformity to European law?
Specific examples on common themes
Can you explain, on the basis of the information available to you, how European law has had an impact on positive law and judicial practices in your country in the three areas below? In other words, what are the normative, jurisdictional and institutional consequences of European standards and the case law of supranational courts in these areas?
• Example 1 (Data protection and retention)
What impact has European law had in your country on the retention of, and access to, connection data for use in the fight against crime? Has your court (or any other court in your country) requested a reference for a preliminary ruling? If that is the case, please explain the impact of the CJEU decision on your legal system.
• Example 2 (Environmental law)
Do you take into account European Union law and the law of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms when dealing with environmental and climate-related disputes? Is it relevant to the study of these issues?
• Example 3 (Criminal law)
In criminal matters, in the context of a European Arrest Warrant, and if this has already been the case, have your courts handed down decisions that set aside the principle of mutual trust in order to prevent an infringement of fundamental rights?
Has your State adopted more severe penalties than the maximum or minimum penalties imposed by Union law? If so, in what areas? Apart from offences relating to the EU's financial interests, has your State created new offences as a result of a European directive?
Finally, the European Arrest Warrant has enabled Member States to simplify extradition within the EU. Have you modified the quantum of certain sentences in order to extend the number of offences for which the European Arrest Warrant can be used?
RÉSEAU DES PRÉSIDENTS DES COURS SUPRÊMES JUDICIAIRES
DE L’UNION EUROPÉENNE
CONFÉRENCE DU RÉSEAU
3–4 OCTOBRE 2024
ATHÈNES, GRÈCE
Questionnaire
Thème : L’effet du droit européen sur le droit national
Etabli par Monsieur Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation française
Dans le questionnaire ci-après le droit européen s’entend comme le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le droit de l’Union européenne. En effet, il s’agit de « deux branches qui, bien que distinctes, s’influencent réciproquement, forment les deux aspects d’une même réalité juridique : celle d’un droit intégré à l’ordre juridique national »1.
Ces droits qui étaient auparavant tant critiqués épousent désormais les ordres juridiques des Etats membres de l’Union européenne. Il ainsi pertinent de parler d’européanisation du droit. Le concept d’européanisation, dans la littérature académique, revêt trois dimensions principales :
1) « Un mouvement vertical allant du haut (les institutions européennes) vers le bas (les Etats membres), à travers lequel le droit de l’Union européenne exerce une influence sur le droit interne ;
2) Un mouvement vertical inverse allant du bas (les Etats membres) vers le haut (les institutions européennes), et prenant la forme de transferts de compétences à l’Union européenne ou de transferts de prérogatives aux institutions européennes (toutefois, le fait que l’adoption de règles européennes, de droit primaire comme de droit dérivé, résulte d’une négociation qui, à l’occasion, peut se révéler plus favorable à un Etat qu’à un autre, n’empêche pas d’y voir, de manière générale, une forme d’européanisation) ;
3) Un mouvement horizontal d’un Etat membre vers un autre. Autrement dit, la convergence des droits nationaux découle alors d’un effet de transfert ou d’imitation : l’Etat reprend à son compte une norme, une règle, un principe issu du droit d’un autre état membre, sans que cela soit imposé d’en haut pas les institutions de l’Union européenne. »2.
Cette européanisation multifactorielle témoigne de l’impact du droit européen sur le droit positif des Etats membres et module l’organisation de l’institution judiciaire. Ce constat est renforcé par une dynamique de fondamentalisation du droit notamment par le biais de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ainsi, dans le dessein de structurer ce questionnaire et nos réflexions futures, permettez-moi de me référer à Madame la professeure Mireille Delmas-Marty qui, dans ses travaux sur La grande complexité du mode juridique3, fait référence aux diverses formes d’intégration juridique, à l’aune de la « mondialisation du droit »4, à savoir « normative, juridictionnelle et institutionnelle, qui se développent simultanément à l’échelle régionale et mondiale ». Ainsi, ce questionnaire sera l’occasion de s’interroger sur la portée de l’impact du droit européen sur le droit positif des Etats membres notamment du point de vue institutionnel (I), juridictionnel (II) et normatif (III). Ces trois parties seront précédées de questions préliminaires d’ordre général et suivies d’exemples portant sur des thématiques communes.
Afin de vous guider dans votre analyse des questions et dans la rédaction de vos réponses, vous trouverez en note de bas de pages de brefs éléments de réponse pour la situation française ainsi qu’en annexe du questionnaire l’ensemble des réponses détaillées de la Cour de cassation française.
Questions préliminaires
(a) Pouvez-vous expliciter la place des dispositions du droit primaire de l’Union européenne et des traités internationaux du Conseil de l’Europe tels que la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans l’ordre juridique interne de votre pays ? Ces dispositions ont-elles une force juridique directement contraignante (tradition moniste) ou doivent-elles être transposées en droit national (tradition dualiste) ou disposez-vous d’un régime mixte ? Existe-t-il des débats à ce sujet ?
(b) Quelle est la place du droit européen par rapport au droit international dans votre Etat (une distinction est-elle effectuée) ?
(c) Dans la même veine, quelle est la place des dispositions de droit européen dans la hiérarchie des normes de votre ordre juridique interne ? En ce sens, nous vous prions de détailler brièvement la jurisprudence de votre pays relative à la construction de cette hiérarchie des normes et au principe de primauté du droit de l’Union européenne.
I§ Impact institutionnel
Quelle incidence du droit européen sur l’organisation institutionnelle des cours suprêmes ?
Question N°1. (a) Le droit européen et la jurisprudence des cours supranationales ont-ils entraîné des réformes de vos institutions ?
Nous vous invitons à fournir quelques exemples pratiques mettant en exergue l’impact institutionnel du droit européen sur votre juridiction (par exemple, à la suite d’un arrêt rendu par la CJUE ou la CEDH).
(b) Quelles réformes récentes dans le domaine de la justice sont intervenues sous l’impulsion de l’Europe dans votre pays ?
Question N°2. Votre pays a-t-il créé une voie de droit et/ou une instance spécialisée permettant de reconnaître en droit interne les effets des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme ? Si oui, celle-ci a-t-elle un lien avec votre juridiction ?
Question N°3. Votre juridiction a-t-elle bénéficié, et plus généralement la justice de votre pays, d’un programme européen ? En cas de réponse positive, quel impact ce programme a-t-il eu sur votre juridiction ?
Question N°4. Dans la perspective d’améliorer la réception du droit européen, quelles sont les méthodes utilisées et les mesures mises en place au sein de votre juridiction pour permettre aux juges et patriciens du droit de votre institution de suivre la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH ? Par ailleurs, les membres de votre juridiction reçoivent-ils une formation en droit européen ?
II§ Impact juridictionnel
Comment le droit européen a-t-il modifié l’office du juge et pénétré la jurisprudence des cours suprêmes judiciaires ?
Question N°5. En quoi considérez-vous que le droit européen a modifié votre office ?
Question N°6. En tant que juge de droit commun du droit de l’Union européenne et premier juge de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales vous référez-vous régulièrement et explicitement dans vos arrêts aux dispositions de droit européen, aux principes généraux du droit et aux décisions rendues par la CJUE et de la CEDH ? En cas de réponse positive, pouvez-vous retracer brièvement l’historique de la réception par votre cour suprême de ces « droits venus d’ailleurs »5, notamment les arrêts marquant cette réception ?
A quelle fin est-il fait référence aux arrêts de la CJUE et de la CEDH dans les décisions de vos juridictions (vis-à-vis des parties prenantes internes/ externes ou pour engager un dialogue judiciaire) ?
Question N°7. (a) Le dialogue des juges est essentiel « à l’échelle européenne où coexistent non seulement les ordres juridiques nationaux et l’ordre juridique communautaire, mais aussi celui issu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale »6. Votre juridiction a-t-elle pour habitude de poser de manière régulière des questions préjudicielles à la CJUE (article 267 TFUE) ou de formuler des demandes d’avis à la CEDH (Protocole n°16) ?
(b) La juridiction nationale décide, en fonction de considérations d'économie et d'utilité procédurales, à quel stade de la procédure il convient d'interroger la CJUE sur question préjudicielle (article 267 TFUE (CJCE, 10 mars 1981, aff. jtes 36/80 et 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, pts 7 à 9 ; CJCE, 7 janv. 2004, aff. C-60/02, X., pt 28)). La demande d’avis (Protocole n°16 à la Convention européenne des droits de l’Homme) répond à la même logique.
Ainsi, en pratique, comment décidez-vous de l’opportunité de recours à ces mécanismes pour poser une question préjudicielle à la CJUE ou pour formuler une demande d’avis à la CEDH ? Y avez-vous plutôt recours à l’initiative des parties ou à la vôtre ?
Question N°8. (a) Avez-vous développé une trame-type ou tout instrument utile aidant les magistrats à formuler une question préjudicielle à la CJUE, à la suite des recommandations de la CJUE (2019/C380/01), dans le dessein d’éviter une demande d’éclaircissement (article 101 du règlement de procédure de la CJUE) ou que la question soit déclarée manifestement irrecevable en ce qu’elles ne respecteraient pas les exigences minimales imposées par la CJUE (exigences prévues notamment à l’article 94 dudit règlement), ou un avis à la CEDH ?
(b) Lorsque vous saisissez une cour supranationale d’une question préjudicielle ou d’une demande d’avis, faîtes-vous valoir la position de votre juridiction sur la question débattue ? Avez-vous le sentiment d’influer sur la jurisprudence de la CJUE ou de la CEDH ?
Question N°9. (a) Dans le cadre du Protocole n°16 à la Convention, sept avis ont été rendus par la CEDH (à la demande de la France, Arménie, Lituanie, Finlande et Belgique) et deux demandes d’avis consultatif ont été rejetées (demandes formulées par l’Estonie et la Slovaquie). Ainsi, avez-vous déjà utilisé ce mécanisme ? Si oui, pouvez-vous rappeler pour quelle(s) affaire(s) et si non, comment expliquez-vous le défaut de recours à ce mécanisme ?
(b) Avez-vous déjà eu l’occasion de vous référer aux avis rendus par la CEDH dans vos décisions alors même que la demande d’avis avait été formulée par un autre Etat membre ? Si oui, pouvez-vous détailler le ou les arrêt(s) en question ?
Question N°10. (a) La CJUE et CEDH motivent leurs arrêts de manière substantielle. Au regard des exigences européennes avez-vous dû modifier votre pratique de motivation de vos décisions de justice ? En cas de réponse positive, pouvez-vous indiquer si une telle réforme a été entreprise à la suite d’une condamnation ou en raison du droit européen ou des pratiques des cours suprêmes voisines ou supranationales ? La méthodologie de rédaction des cours européennes a-t-elle influencé votre manière de motiver vos arrêts (par exemple, faire davantage de références à vos précédents jurisprudentiels ou au droit comparé) ?
(b) Pensez-vous que le droit européen a fait évoluer la notion de jurisprudence dans les systèmes de droit continental ?
Question N°11. Pouvez-vous référencer, dans la mesure du possible, des décisions rendues par votre juridiction
(a) Tenant compte explicitement ou implicitement de la marge nationale d’appréciation prévue par le droit européen ;
(b) Reprenant l’interprétation de la CJUE/ CEDH et écartant une jurisprudence nationale ;
Pour aller plus loin. L’impact du droit européen : dialogue des juges et influence extraterritoriale du droit européen
Question N°12. Comme évoqué dans mes propos introductifs l’européanisation est aussi marquée par un mouvement horizontal d’un Etat membre vers un autre. La reprise des jurisprudences des autres Etats membres dans les arrêts illustre parfaitement ce mouvement. Votre juridiction accorde-t-elle une place importante au droit comparé dans sa motivation ?
Question N°13. Avez-vous connaissance d’un arrêt de la CEDH ou de la CJUE ou de l’une de vos décisions rendues en application du droit européen qui auraient été reprises par une cour suprême d’un Etat tiers ?
III§ Impact normatif
Comment le droit européen s’est-il répercuté sur les règles de droit interne des Etats membres ?
Question N°14. L’européanisation se caractérise par un mouvement vertical allant du haut vers le bas et d’un mouvement vertical allant du bas vers le haut. Ainsi, deux interrogations :
(a) Pouvez-vous estimer, à l’aune des informations dont vous disposez, le nombre de dispositions nationales ayant une origine européenne ?
(b) Quels liens le pouvoir législatif entretient avec les institutions européennes ? Par ailleurs, le pouvoir législatif de votre pays collabore-t-il activement avec les institutions européennes dans le processus d’élaboration des normes européennes ?
Question N°15. En droit de l’Union européenne, votre pays transposent-ils totalement l’ensemble des directives européennes et plus généralement accordent-ils sa législation à l’ensemble des normes européennes ? En ce sens, avez-vous connaissance des recours en manquement de la Commission européenne débutés contre votre Etat pour violation du droit de l’Union européenne par une autorité judiciaire ces dernières années (article 258 TFUE) et pour manquement à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive (article 260§3 TFUE) ?
Question n°16. Lorsque votre juridiction applique du droit dérivé, citez-vous directement la directive (ou davantage la loi de transposition) ? Vous référez-vous aux travaux préparatoires des dispositions européennes dans la motivation de vos décisions (interprétation téléologique) ?
Question N°17. Pouvez-vous à la lumière des éléments dont vous disposez, indiquer quels sont les grands arrêts rendus par la CEDH ayant eu un impact jurisprudentiel/normatif sur l’organisation et le fonctionnement de votre système juridique7 (idée de dialogue tripartites : juge supranational, juge national et législateur) ?
Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à fournir des exemples d’arrêts pris par votre cour en réponse à un arrêt européen ayant conduit à une réforme législative (arrêt de condamnation, arrêts validant vos évolutions législatives, arrêts rendus contre d’autres Etats membres vous ayant impacté, etc.).
Question N°18. L’impact du droit européen se traduit également par une idée d’équivalence des dispositions européennes et nationales, notamment constitutionnelles. C’est en ce sens que la CEDH, lorsqu’elle interprète l’obligation pour le requérant de soulever en substance le grief tiré de la violation de la Convention, a notamment admis que les requérants puissent s’appuyer sur des dispositions équivalentes du droit interne (affaire Guberina contre Croatie, 22 mars 2016, n°23682/13)8. La question se pose également du point de vue du juge national. Lors d’un contrôle de conformité d’un acte national, transposant le droit de l’Union européenne, avec d’une disposition constitutionnelle qui trouve son équivalent en droit de l’Union européenne, les cours supérieures de votre pays mobilisent-elles la disposition constitutionnelle ou européenne ? Autrement dit, appliquent-t-elles la théorie de l’équivalence des droits dans leur contrôle de conformité ?
Exemples concrets portant sur des thématiques communes
Pouvez-vous expliquer, à l’aune des informations dont vous disposez, comment dans les trois domaines ci-après le droit européen a impacté le droit positif et les pratiques judiciaires de votre pays ? En d’autres termes, quelles sont les conséquences normatives, juridictionnelles et institutionnelles des normes européennes et des jurisprudences des cours supranationales dans ces domaines ?
• Exemple thématique n°1 (protection et conservation des données)
Quel impact le droit européen a-t-il eu dans votre pays sur la conservation et l’accès aux données de connexion à des fins de lutte contre la criminalité ? En la matière, votre juridiction (ou toute autre judication de votre pays) a-t-telle effectuée un renvoi préjudiciel ? En cas de réponse positive, expliquez l’impact de la décision de la CJUE sur votre système juridique.
• Exemple thématique n°2 (droit de l’environnement)
Prenez-vous en compte le droit de l’Union européenne et le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme lorsque vous connaissez de contentieux environnementaux et climatiques ? Est-il pertinent dans l’étude de ces questions ?
• Exemple thématique n°3 (droit pénal)
En matière pénale, dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, et si cela a déjà été le cas, vos juridictions ont-elles rendu des décisions écartant le principe de confiance mutuelle afin de prévenir une atteinte aux droits fondamentaux ?
Votre Etat a-t-il adopté des peines plus sévères que les peines maximales ou minimales imposées par le droit de l’Union ? Si tel est le cas, dans quels domaines ? Outre les infractions liées aux intérêts financiers de l’Union, vos Etats ont-ils été amenés à créer de nouvelles infractions à la suite d’une directive européenne ?
Enfin, le mandat d’arrêt européen a permis aux Etats membres de simplifier l’extradition au sein de l’Union, avez-vous modifié le quantum de certaines peines afin d’élargir le nombre d’infractions permettant l’utilisation du mandat d’arrêt européen ?
Annexe au questionnaire
Réponses de la Cour de cassation française1
Questions préliminaires
(a) Pouvez-vous expliciter la place des dispositions du droit primaire de l’Union européenne et des traités internationaux du Conseil de l’Europe tels que la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans l’ordre juridique interne de votre pays ? Ces dispositions ont-elles une force juridique directement contraignante (tradition moniste) ou doivent-elles être transposées en droit national (tradition dualiste) ou disposez-vous d’un régime mixte ? Existe-t-il des débats à ce sujet ?
Réponse : (a) La France a une tradition moniste en droit des traités. L’article 55 de la Constitution française de 1958 (« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ») prévoit que les traités approuvés ont dès leur application une autorité supérieure à celle des lois. Il n’est pas nécessaire pour le législateur de transposer les traités en droit national.
Toutefois, l’article 53 de la Constitution (« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. ») prévoit pour sa part que plusieurs catégories de traités ou d’accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Sont ainsi visés :
- les traités de paix,
- les traités de commerce,
- les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale,
- les traités engageant les finances de l’État,
- les traités modifiant des dispositions de nature législative,
- les traités relatifs à l’état des personnes,
- les traités comportant cession, échange ou adjonction de territoire.
Il en résulte que les accords conclus par l’Union européenne sont soumis au Parlement national lorsqu’ils interviennent dans un domaine de compétence partagée entre l’Union et les États membres (autrement dit, ils échappent à cette règle lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive de l’Union européenne mais non lorsqu’ils relèvent au moins en partie de la compétence nationale).
Les dispositions prévues à l’article 53 de la Constitution conduisent à ce qu’environ le tiers des traités et accords conclus par la France soient soumis au Parlement avant entrée en vigueur2.
Le Conseil d’État veille notamment à ce que tout accord portant sur des matières de nature législative ou ayant une incidence financière fasse l’objet d’un projet de loi autorisant sa ratification.
Par ailleurs, l’autorisation de ratifier certains traités peut être subordonnée à la modification de la Constitution en cas de clause contraire, dans le traité, à cette dernière (en ce que la Constitution demeure la norme supérieure). Le Conseil constitutionnel a compétence pour apprécier si le traité devant être ratifié comporte une clause contraire à la Constitution.
Exemples de l’impact de l’intégration européenne sur la Constitution : le Conseil constitutionnel avait jugé dans sa décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 que l’autorisation de ratifier ce traité ne pouvait intervenir qu’après révision de la Constitution ; la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 a été adoptée par le Parlement convoqué en Congrès en vertu de l’article 89 de la Constitution. Cette révision a ajouté un article 53-1 dans la Constitution afin de permettre à la France de conclure avec les États européens des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées ; la révision constitutionnelle du 25 janvier 1999 a été adoptée par le Parlement convoqué en Congrès en vertu de l’article 89 de la Constitution. Elle a tiré les conséquences de la décision n° 97-394 DC du 31 décembre 1997 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que l’autorisation de ratifier le traité d’Amsterdam ne pouvait intervenir qu’après révision de la Constitution ; la révision constitutionnelle du 4 février 2008 a été adoptée par le Parlement convoqué en Congrès en vertu de l’article 89 de la Constitution. Elle a tiré les conséquences de la décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que l’autorisation de ratifier le traité de Lisbonne devait être précédée d’une révision de la Constitution)3.
(b) Quelle est la place du droit européen par rapport au droit international dans votre Etat (une distinction est-elle effectuée) ?
Réponse : Le droit européen et le droit international forment le bloc de conventionnalité dans la hiérarchie des normes françaises. Dans l’ordre interne, ils ont une valeur supérieure à celle de la loi mais inférieure à la Constitution. Cette affirmation est partagée par la Cour de cassation (« la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle » ; arrêt d’Assemblée plénière, 2 juin 2000, 99-60.274, Publié au bulletin4), le Conseil d’Etat (voir en ce sens, arrêt Sarran et Levacher du 30 octobre 1998) et le Conseil constitutionnel.
Néanmoins, le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2004-505 DC du 19 novembre 2004 a expressément énoncé que « aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; que le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international » (considérant 11 de la décision). Le droit de l’Union européenne occupe ainsi une place particulière dans l’ordre juridique français du fait de ses particularités (effet direct des dispositions communautaires, transposition des directives, etc.) et est distinct de l’ordre juridique international.
(c) Dans la même veine, quelle est la place des dispositions de droit européen dans la hiérarchie des normes de votre ordre juridique interne ? En ce sens, nous vous prions de détailler brièvement la jurisprudence de votre pays relative à la construction de cette hiérarchie des normes et au principe de primauté du droit de l’Union européenne.
Réponse : Comme évoqué, le droit européen, malgré le principe de primauté du droit de l’Union européenne (CJUE, Costa contre Enel, 15 juillet 1964, affaire 6-64 et la déclaration annexée au traité de Lisbonne de 2007 portant le Numéro 17) a une autorité inférieure à la Constitution. Autrement dit, le droit de l’Union européenne prime uniquement sur la loi nationale. En ce sens, l’arrêt dit Jacques Vabre de la Cour de cassation5 consacre le principe de primauté du droit de l’Union européenne sur la loi.
Cour de cassation, chambre mixte, 24 mai 1975, pourvoi 73-13.556 : « mais attendu que le traité du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article susvisé de la constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des états membres ; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces états et s'impose à leurs juridictions ».
Hiérarchie des normes : quid de normativité de la jurisprudence à l’aune de l’européanisation et de la fondamentalisation du droit (CJUE, « juge de droit commun » et CEDH, « ère de la subsidiarité »6) ?
I§ Impact institutionnel
Comment le droit européen a-t-il chamboulé l’organisation institutionnelle des cours suprêmes ?
Question N°1. (a) Le droit européen et la jurisprudence des cours supranationales ont-ils entraîné des réformes de vos institutions ?
Nous vous invitons à fournir quelques exemples pratiques mettant en exergue l’impact institutionnel du droit européen sur votre juridiction (par exemple, à la suite d’un arrêt rendu par la CJUE ou la CEDH).
(b) Quelles réformes récentes dans le domaine de la justice sont intervenues sous l’impulsion de l’Europe dans votre pays ?
Réponse à la Question N°1.
(a) D’une part, concernant l’impact institutionnel du droit européen sur le fonctionnement interne de la Cour de cassation, voici deux exemples significatifs :
• (Article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme) Impact sur la présence de l’avocat général au délibéré. La CEDH a énoncé que l’avocat général près la Cour de cassation n’est pas une partie au procès mais un membre du parquet conseillant les juges par le biais de ses conclusions. La CEDH dans plusieurs arrêts a précisé les missions de l’avocat général et les conséquences de son statut atypique. En effet, ce dernier possède un rôle de conseiller, il fait pencher la balance du côté de l’accusation ou du côté de la défense. Ainsi, lorsqu’il participe au délibéré avec voix consultative, cela lui offre une occasion supplémentaire pour orienter la décision (CEDH 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd contre France, n°22021/93 et 23043/93). La Cour de cassation a donc dû revoir les missions de l’avocat général. Aujourd’hui, il n’assiste plus au délibéré. Dans la même veine, la place du commissaire du gouvernement près du Conseil d’Etat a dû être revue.
• (Article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme) Aménagements des méthodes de travail et d’examen des dossiers. Le rôle et les prérogatives procédurales traditionnelles du parquet général ont été remis en question par le juge européen à l’occasion de l’examen de la conformité de la procédure du pourvoi en cassation aux exigences du procès équitable (CEDH, 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd contre France, req. n°23043 etn°22921/93). La CEDH avait jugé que le défaut de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur dans des conditions identiques à leur communication à l’avocat général ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable. La Cour de cassation a depuis modifié les modalités d’instruction et de jugement de ses affaires. Sont désormais connus des parties le rapport examinant les points de droit faisant difficulté à juger et l’avis de l’avocat général, l’avis du rapporteur et les projets d’arrêt étant quant à eux couverts par le secret du délibéré, auquel n’assiste pas l’avocat général, comme énoncé précédemment. Le juge européen a admis la conventionnalité du dispositif (CEDH, 23 mai 2006, Marion contre France, req. n°43751/02; Cf. V. Lamanda, « L’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation »).
(b) De nombreuses réformes trouvent leur origine dans des initiatives de la Commission européenne ou font suite à des arrêts marquants des juridictions européennes : la numérisation complète des procédures judiciaires civiles et pénales ; l’accès en ligne aux décisions de justice s’est encore amélioré et le Conseil constitutionnel a lancé un nouveau portail numérique pour consulter la jurisprudence sur les questions prioritaires de constitutionnalité ; recours à la motivation enrichie par la Cour de cassation ; etc.
Pour plus d’informations : 1562070d-fc16-4cfc-83be-a1c6e559a08c_en.pdf (europa.eu)
Question N°2. Votre pays a-t-il créé une voie de droit et/ou une instance spécialisée permettant de reconnaître en droit interne les effets des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme ? Si oui, celle-ci a-t-elle un lien avec votre juridiction ?
Réponse à la Question N°2. La France a créé une procédure de réexamen des affaires pénales depuis la loi du 15 juin 2000 (article 622-1 du code de procédure pénale et L. 451-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire) et des affaires civiles d’état des personnes depuis la loi du 18 novembre 2016 (article 1031-8 du code de procédure civile et L. 452-1 et s. du code de l’organisation judiciaire) lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la CEDH que la décision définitive rendue a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la CEDH ne pourrait mettre un terme. Dans le cadre de cette procédure, la Cour de cassation statue en qualité de « Cour de révision et de réexamen ». En effet, la Cour de révision compte dix-huit magistrats de la Cour de cassation.
Question N°3. Votre juridiction a-t-elle bénéficié, et plus généralement la justice de votre pays, d’un programme européen ? En cas de réponse positive, quel impact ce programme a-t-il eu sur votre juridiction ?
Réponse à la Question N°3. En dehors des plans nationaux, la Cour de cassation n’a pas bénéficié à titre de juridiction individuelle d’un plan de financement européen.
Question N°4. Dans la perspective d’améliorer la réception du droit européen, quelles sont les méthodes utilisées et les mesures mises en place au sein de votre juridiction pour permettre aux juges et patriciens du droit de votre institution de suivre la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH ? Par ailleurs, les membres de votre juridiction reçoivent-ils une formation en droit européen ?
Réponse à la Question N°4 : Afin d’améliorer la réception du droit européen la Cour de cassation :
• Délivre une formation sur la question préjudicielle aux nouveaux arrivants à la Cour ;
• Coorganise des stages à la CJUE et CEDH pour les nouveaux magistrats ;
• Encourage les détachements au sein des juridictions européennes ;
• Recrute des spécialistes en droit européen (anciens référendaires à la CJUE, juristes et magistrats spécialisés, etc.) ;
• Encourage la participation de ses membres à des réseaux européens ;
• A mandaté deux groupes de travail, respectivement sur le contrôle de conventionnalité et sur les liens avec la CJUE. Le premier a rédigé, en 2018, un mémento à destination des magistrats de la Cour ; le second a établi une trame-type de rédaction de question préjudicielle et un guide à l’intention des magistrats.
S’agissant du suivi des évolutions jurisprudentielles et des actualités des cours supranationales, d’une part, le Bureau du droit comparé du Service de documentation, des Etudes et du Rapport (SDER) apporte un soutien aux magistrats de la Cour de cassation et du fond sur ces questions et exerce également une activité de veille juridique, d’autre part, le service des relations internationales du cabinet du premier président assure une activité de veille juridique pour la première présidence et les membres du cabinet. Enfin, les réseaux européens, auxquels la Cour et ses membres participent, permettent de rester informé des évolutions (newsletters).
Enfin, des réflexions sont menées pour optimiser les retours à la suite de condamnations de la CEDH.
II§ Impact juridictionnel
Comment le droit européen a-t-il modifié l’office du juge et pénétré la jurisprudence des cours suprêmes judiciaires ?
Question N°5. En quoi considérez-vous que le droit européen a modifié votre office ?
Réponse à la Question N°5.
(Union européenne) L’avènement de la construction européenne a modifié l’office du juge judiciaire. Auparavant, « bouche de la loi »7, le juge national s’est vu confier le pouvoir d’écarter une loi nationale au profit d’une norme européenne supérieure mais aussi de prendre des mesures conservatoires afin de garantir aux justiciables les droits qu’ils tirent du droit de l’Union européenne. Les juges nationaux sont devenus les « juges de droit commun » du droit de l’Union européenne8. Ils ont reçu pour mission « d'appliquer, dans le cadre de [leur] compétence, les dispositions du droit communautaire, [avec] l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de [leur] propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'[ils aient] à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ».
(Convention européenne des droits de l’Homme) Dans la même veine, les juges judiciaires sont devenus les premiers juges de la Convention européenne des droits de l’Homme (principe de subsidiarité). En effet, la CEDH a expressément énoncé que les juges nationaux sont les mieux placés pour déterminer quelles mesures sont nécessaires pour garantir dans leur pays les droits et libertés découlant de la Convention européenne des droits de l’Homme9 . Le juge de la cassation s’est emparé du contrôle de conventionnalité (contrôle in abstracto des dispositions nationales par rapport à la Convention européenne des droits de l’Homme), et de la marge nationale d’appréciation et du contrôle de proportionnalité dans son raisonnement.
Le juge de cassation a dès lors vu son office se modifier. Outre l’extension des réglementations qu’il se doit d’appliquer, sa méthodologie a évolué afin de s’approprier le contrôle de conventionalité et le contrôle de proportionnalité. En ce sens, la Cour de cassation, dans l’un de ses arrêts du 15 avril 2011, a reconnu la nécessité pour les États de respecter la jurisprudence de la CEDH (« sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation »).
Question N°6. En tant que juge de droit commun du droit de l’Union européenne et premier juge de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales vous référez-vous régulièrement et explicitement dans vos arrêts aux dispositions de droit européen, aux principes généraux du droit et aux décisions rendues par la CJUE et de la CEDH ? En cas de réponse positive, pouvez-vous retracer brièvement l’historique de la réception par votre cour suprême de ces « droits venus d’ailleurs »10 , notamment les arrêts marquant cette réception ?
A quelle fin est-il fait référence aux arrêts de la CJUE et de la CEDH dans les décisions de vos juridictions (vis-à-vis des parties prenantes internes/ externes ou pour engager un dialogue judiciaire) ?
Réponse à la Question N°6. La Cour de cassation se réfère régulièrement aux arrêts des cours supranationales dans sa motivation (notamment depuis 2019 avec la réforme de la rédaction et de la motivation de ses arrêts). Les références aux arrêts de la CJUE et de la CEDH dans les décisions de la Cour de cassation ont pour finalité première d’assurer la traçabilité de la décision et de rendre son raisonnement intelligible. En ce sens, elles permettent aux lecteurs de bénéficier de l’ensemble des sources du droit et de leur articulation ayant abouti à la décision rendue. Par ailleurs, ces références permettent d’engager un dialogue judicaire horizontal et/ou vertical avec les juridictions nationales, les instances européennes, et d’autres juridictions internationales. La Cour souhaite que sa jurisprudence reflète la variété de normes applicables et s’ouvre aussi sur le monde en offrant une place au droit comparé, même quand il s’agit d’évoquer des analyses ou décisions étrangères non contraignantes pour le juge français.
Quelle réception par la Cour de cassation du droit européen ?
1§ Historique de la réception du droit de l’Union européenne par la Cour de cassation. Les juridictions françaises accordent une place particulière au droit de l’Union européenne. En effet, la France, pays fondateur de l’Union européenne, a très rapidement réceptionné et appliqué les normes communautaires. Cette réception débute en 1975. La chambre mixte de la Cour de cassation doit juger si la Cour d’appel a, à bon droit, écarté l’application d’une taxe prévue par le Code des douanes du fait de son incompatibilité avec le traité de Rome, en retenant que ce traité, en vertu de l’article 55 de la Constitution, avait une autorité supérieure. La chambre mixte de la Cour de cassation confirme cette décision le 24 mai 1975, pourvoi 73-13.556, dans son arrêt dit Jacques Vabre. A cette occasion, la Cour se déclare compétente pour exercer le contrôle de conventionnalité (à la suite de la décision IVG du Conseil constitutionnel, décision 74-54 DC du 15 janvier 1975).
« Mais attendu que le traité du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article susvisé de la Constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des Etats membres ; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces Etats et s'impose à leurs juridictions »
Ainsi, comme évoqué précédemment, l’arrêt Jacques Vabre consacre la primauté du droit de l’Union européenne sur la loi interne.
A partir de 1975, le juge judicaire accepte de devenir le juge de droit commun du droit communautaire (expression tirée de l’arrêt Simmenthal rendu par la CJUE).
2§ Historique de la réception de la Convention européenne des droits de l’Homme par la Cour de cassation. La Cour de cassation a d’abord pu faire preuve d’une certaine réserve, en développant les « méthodes utilisées pour contenir les effets de la Convention »11 au profit d’une primauté du droit interne : refus des chambres civiles de la Cour de cassation de soulever d’office l’application de la Convention européenne comme moyen de pur droit ou d’ordre public ; affirmation de la non-contrariété de la loi interne à la Convention12 ; mise hors du champ d’application de la Convention européenne13 ; limitation des effets des arrêts de la Cour européenne en droit interne ; méthodes d’application restrictive de la Convention14.
Toutefois, en 1975, dans un arrêt de la chambre criminelle du 3 juin 1975, Respino (75-90687), la Cour de cassation reconnaît pour la première fois que les dispositions de la Convention sont directement applicables en France et invocables devant les juridictions15 (cela est réitéré dans un arrêt Cass, crim, 30 juin 1976, Eisner, Glaser, Munoz-Rojo, pourvoi n°75-93296).
En 1978, la Cour casse un arrêt pour inobservation d’une disposition de la Convention (articles 6 et 13 en l’espèce) dans une affaire Cass, crim, 5 décembre 1978, Baroun, pourvoi n°78-91826. Ainsi, devant la Cour de cassation, la Convention a d’abord été invoquée dans des litiges pénaux.
Autres évolutions majeures devant la Cour de cassation :
• La première chambre civile, par son arrêt « Rennemann » (Cass. 1ère civ., 10 janv. 1984, Rennemann, n° du pourvoi : 82-16.968) a été la première chambre civile à se référer explicitement à une décision de la CEDH. Historiquement la première chambre civile est la première chambre en matière civile à avoir effectué des contrôles de conventionnalité.
• La chambre criminelle a aussi été la première, dans sa décision « Bacha Baroudé » (Cass., crim., 15 mai 1990, Bacha Baroudé, n° du pourvoi : 90-80827) à opérer un revirement de jurisprudence pour tenir compte d’un arrêt de la CEDH qui avait condamné la France trois semaines plus tôt par ses célèbres arrêts Kruslin et Huvig (CEDH, 24 avril 1990, Kruslin, req. n°11801/85 et CEDH, 24 avril 1990, Epoux Huvig, req. n°11105/84).
Aujourd’hui, les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme et la jurisprudence de la CEDH sont pleinement intégrées dans la motivation des arrêts de la Cour de cassation française.
Question N°7. (a) Le dialogue des juges est essentiel « à l’échelle européenne où coexistent non seulement les ordres juridiques nationaux et l’ordre juridique communautaire, mais aussi celui issu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale »16. Votre juridiction a-t-elle pour habitude de poser de manière régulière des questions préjudicielles à la CJUE (article 267 TFUE) ou de formuler des demandes d’avis à la CEDH (Protocole n°16) ?
(b) La juridiction nationale décide, en fonction de considérations d'économie et d'utilité procédurales, à quel stade de la procédure il convient d'interroger la CJUE sur une question préjudicielle (article 267 TFUE (CJCE, 10 mars 1981, aff. jtes 36/80 et 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, pts 7 à 9 ; CJCE, 7 janv. 2004, aff. C-60/02, X., pt 28)). La demande d’avis (Protocole n°16 à la Convention européenne des droits de l’Homme) répond à la même logique.
Ainsi, en pratique, comment décidez-vous de l’opportunité de recours à ces mécanismes pour poser une question préjudicielle à la CJUE ou pour formuler une demande d’avis à la CEDH ? Y avez-vous plutôt recours à l’initiative des parties ou à la vôtre ?
Réponse à la Question N°7. (a) Les chambres de la Cour de cassation, malgré la mise en place d’une trame-type, effectuent toujours peu de renvois préjudiciels à la CJUE.
Statistiques – article 267 TFUE (renvoi préjudiciel la CJUE)17 :
• En 2021, 8 questions posées à la CJUE (une par la chambre criminelle, deux par la première chambre civile, deux par la chambre sociale, une par la chambre commerciale, deux par la deuxième chambre civile)
• En 2022, 2 questions posées à la CJUE (une par la première chambre civile et une par la chambre commerciale).
• En 2023, 6 questions posées (une par la chambre sociale, deux par la chambre commerciale, financière et économique, une par la chambre criminelle, une par la première chambre civile et une par la deuxième chambre civile) ;
• En 2024, 1 question posée (par la chambre commerciale, financière et économique).
Statistiques – Protocole n°16 (demande d’avis à la CEDH) : la Cour de cassation a formulé une seule demande d’avis à la CEDH. Toutefois, la CEDH n’a rendu que 7 avis sur la base du Protocole n°16. Pour rappel, la Cour de cassation française a été la première haute juridiction à se saisir de ce mécanisme dans le cadre d’une affaire portant sur la gestion pour autrui18.
(b) En pratique la décision d’opérer un renvoi préjudiciel est décidée au stade du délibéré. Statistiquement, elle est principalement demandée par les parties mais elle peut également être soulevée d’office. En ce cas, la pratique de la Cour est de mettre dans les débats la possibilité de transmettre une question préjudicielle (dans le dessein de respecter le principe du contradictoire) ou une demande d’avis.
Par la suite, les demandes sont transmises par la direction de greffe aux cours supranationales.
Question N°8. (a) Avez-vous développé une trame-type ou tout instrument utile aidant les magistrats à formuler une question préjudicielle à la CJUE, à la suite des recommandations de la CJUE (2019/C380/01), dans le dessein d’éviter une demande d’éclaircissement (article 101 du règlement de procédure de la CJUE ) ou que la question soit déclarée manifestement irrecevable en ce qu’elles ne respecteraient pas les exigences minimales imposées par la CJUE (exigences prévues notamment à l’article 94 dudit règlement), ou un avis à la CEDH ?
(b) Lorsque vous saisissez une cour supranationale d’une question préjudicielle ou d’une demande d’avis, faîtes-vous valoir la position de votre juridiction sur la question débattue ? Avez-vous le sentiment d’influer sur la jurisprudence de la CJUE ou de la CEDH ?
Réponse à la Question N°8. (a) (CJUE) Comme évoqué, la Cour de cassation a développé un guide pour la rédaction d’un renvoi préjudiciel à la CJUE et une proposition de trame de renvoi préjudiciel. Ce guide a été élaboré conformément aux recommandations de la CJUE (2019/C380/01). Cet outil facilite le travail des magistrats de la Cour dans leur demande de renvoi préjudiciel et permet de renforcer la lisibilité des décisions de renvoi.
Au regard des informations dont nous disposons19, depuis 2021 aucun renvoi préjudiciel de la Cour de cassation n’a fait l’objet d’une demande d’éclaircissement (article 101 du règlement de procédure de la CJUE) de la part de la CJUE ou n’a été déclaré manifestement irrecevable en ce qu’il ne respectait pas les exigences minimales (exigences prévues notamment à l’article 94 dudit règlement).
Toutefois, les questions de la Cour de cassation ne sont pas à l’abri de faire l’objet d’une reformulation (par exemple, les conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire C-633/22 dite Real Madrid Club de Fútbol propose une reformulation des questions afin de répondre à ces dernières de manière utile).
(CEDH) En revanche, la Cour de cassation n’a pas développé de trame-type pour les demandes d’avis à la CEDH.
(b) Dans un certain nombre d’arrêts de renvoi tant les chambres civiles que la chambre criminelle de la Cour de cassation ont incité, dans leurs questions préjudicielles, la CJUE à modifier sa jurisprudence. Toutefois, les chambres de la Cour, lorsqu’elles effectuent un renvoi, n’ont pas pour coutume de transmettre à la Cour le rapport du conseiller rapporteur.
Question N°9. (a) Dans le cadre du Protocole n°16 à la Convention, sept avis ont été rendus par la CEDH (à la demande de la France, Arménie, Lituanie, Finlande et Belgique) et une demande d’avis consultatif a été rejetée (demande formulée par la Slovaquie). Ainsi, avez-vous déjà utilisé ce mécanisme ? Si oui, pouvez-vous rappeler pour quelle(s) affaire(s) et si non, comment expliquez-vous le défaut de recours à ce mécanisme ?
(b) Avez-vous déjà eu l’occasion de vous référer aux avis rendus par la CEDH dans vos décisions alors même que la demande d’avis avait été formulée par un autre Etat membre ? Si oui, pouvez-vous détailler le ou les arrêt(s) en question ?
Réponse à la question N°9. (a) La Cour de cassation a saisi la CEDH d’une demande d’avis (avis CEDH, 2019, Demande no P16-2018-001). Cette demande portait sur la transcription de la filiation d’un enfant né à l’étranger issu d’une gestion pour autrui.
Ci-après les questions soumises à la CEDH pour avis dans le cadre de cette procédure : « 1. En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d’intention », alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le « père d’intention », père biologique de l’enfant, un État-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d’intention » ?
2. Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ? »
(b) Sur la question de savoir si les cours suprêmes se sont appropriées ce mécanisme, il est pertinent de souligner que celui-ci a été mis en place récemment.
Depuis l’adoption du protocole, la CEDH a d’ores et déjà été saisie 8 fois (dont 1 rejet) ce qui témoigne de son potentiel. D’une part, le recours à cet outil par les juridictions supérieures va certainement s’accroître comme cela a pu être le cas pour le renvoi préjudiciel à la CJUE. Au début de la construction européenne, les juridictions des Etats membres étaient frileuses quant à l’idée d’opérer un renvoi préjudiciel. Désormais, le traitement des renvois préjudiciels représente 67,74% des affaires introduites devant la CJUE (chiffres de 2018-2022)20.
D’autre part, le mécanisme d’appropriation de la Convention par les juges nationaux, le principe de subsidiarité et le mécanisme de la marge nationale d’appréciation, conduisant à un contrôle du processus par la CEDH, rend nécessairement moins récurrent le besoin d’avis.
(c) La Cour de cassation dans sa motivation n’a jamais eu l’opportunité de se référer aux avis rendus par la CEDH à la demande d’un autre Etat membre.
Question N°10. (a) La CJUE et CEDH motivent leurs arrêts de manière substantielle. Au regard des exigences européennes avez-vous dû modifier votre pratique de motivation de vos décisions de justice ? En cas de réponse positive, pouvez-vous indiquer si une telle réforme a été entreprise à la suite d’une condamnation ou en raison du droit européen ou des pratiques des cours suprêmes voisines ou supranationales ? La méthodologie de rédaction des cours européennes a-t-elle influencé votre manière de motiver vos arrêts (par exemple, faire davantage de références à vos précédents jurisprudentiels ou au droit comparé)
(b) Pensez-vous que le droit européen a fait évoluer la notion de jurisprudence dans les systèmes de droit continental ?
Réponse à la Question N°10. (a) La Cour de cassation française a entamé, dès l’automne 2014, un processus de réflexion autour de la rédaction de ses arrêts et a commencé, en décembre 2015, à pourvoir ses arrêts les plus importants d’une motivation dite développée. A l’origine, la Cour de cassation rédigeait ses arrêts de façon immuable et autoritaire.
Nul doute que l’appropriation de la jurisprudence européenne a grandement influencé la Cour de cassation et l’a encouragée à modifier sa méthode de rédaction. Par exemple, la Cour de cassation a adapté sa motivation à la suite d’arrêts de condamnation prononcé par la CEDH (CEDH, 14 mars 2019, Quilichini contre France, req. n°38299/15, §44 « une motivation mieux développée [lui] aurait permis […] de mieux prendre en compte [son] raisonnement » & CEDH, ZB contre France, 2 septembre 2021 §66 dans lequel la Cour indique : « En dépit de la contribution qu’apporte en l’espèce l’avis de l’avocat général à la compréhension de la solution, une motivation plus développée de la décision aurait permis de mieux appréhender et comprendre le raisonnement tenu par la Cour de cassation en ce qui concerne le moyen tiré de l’article 10 de la Convention ».).
Historique : Dans un premier temps, en 2017, a été créée une commission chargée de produire un projet de lignes directrices à la rédaction des arrêts. Ce premier travail de réflexions comportait également des recommandations sur l’enrichissement de la motivation des arrêts de la Cour de cassation. Achevés en 2018, ces travaux ont conduit aux nouvelles règles de rédaction en style direct applicables à toutes les décisions depuis le 1er octobre 2019 et à un guide méthodologique accessible à chaque conseiller. Aussi, les arrêts les plus importants bénéficient désormais plus systématiquement d’une motivation développée. En effet, dans son arrêt d’assemblée plénière du 2 avril 2021, la Cour de cassation a ainsi rappelé : « l’exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme21 ». La motivation développée, dite classique, peut se définir comme la mention « d’un élément traditionnellement passé sous silence, mais sans en faire un maillon du raisonnement, telle que la simple citation d’un précédent 22». Dans un second temps, cette réforme de la rédaction et de la motivation dite développée s’est poursuivie par une réflexion sur les fonctions explicatives et justificatives de l'arrêt. La Cour de cassation utilise pour certaines de ses décisions une motivation dite enrichie. Un groupe de travail sur la motivation enrichie a été diligenté le 26 septembre 2022. Ce groupe a notamment élaborer un guide de méthodologie de la motivation enrichie. Ce dernier a été publié le 26 septembre 2023. Ce guide propose des cadres de rédaction (des trames-type) dans un souci d’harmonisation des pratiques des chambres23. La motivation enrichie se définit ainsi comme une « motivation qui mentionne des éléments traditionnellement passés sous silence et qui articule de manière à ce qu’ils constituent les maillons intermédiaires du raisonnement justifiant le principe posé dans la décision24 ». L’ambition postulée est qu’un arrêt, même complexe, doit pouvoir se suffire à lui-même, sans renvoi au rapport, avis ou notice explicative, et convaincre les parties prenantes. Toutefois, la Cour de cassation française réserve la motivation enrichie aux décisions les plus importantes. La motivation enrichie est également la porte d’entrée du droit comparé dans les décisions des cours suprêmes
Pour résumer on peut dire que l’impact de la jurisprudence des cours suprêmes sur les méthodes de rédaction de la Cour de cassation se situe sur deux registres différents : 1) Le registre des exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme 2) Le registre de l’exemplarité : En citant ses propres précédents et en évoquant la position de l’avocat général, la Cour de cassation s’inspire des modes de rédaction auxquels recourt la CJUE
(b) Face à la multiplication et à l’enchevêtrement des normes, la jurisprudence traditionnellement non reconnue comme source de droit dans notre système juridique de droit continental, devient de plus en plus normative (idée de précédent).
Par le contrôle de la norme textuelle (contrôle de conventionalité), la jurisprudence évoluait déjà vers plus de normativité. Par ailleurs, le poids de la jurisprudence des cours supranationales et leur applicabilité erga omnes a modifié les contours du principe de légalité, le faisant basculer d’une légalité de type formel à une légalité de type matériel. Par ruissellement, la jurisprudence nationale, sous l’impulsion de celle des cours européennes, s’est empreinte de normativité. Le juge national a alors dû appliquer des principes dégagés par les cours supranationales, se montrant alors créateur de droit (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de cassation créant de manière prétorienne un recours préventif et effectif pour les détenus25).
D’ailleurs, les exigences nouvelles formulées à l’endroit de la jurisprudence marquent ce changement de conception de celle-ci comme source du droit : exigence de prévisibilité et application du principe de non rétroactivité de la loi pénale par exemple26, renforcement de la motivation, études d’impact des décisions…
Question N°11. Pouvez-vous référencer, dans la mesure du possible, des décisions rendues par votre juridiction
• (a) Tenant compte explicitement ou implicitement de la marge nationale d’appréciation prévue par le droit européen ;
• (b) Reprenant l’interprétation de la CJUE/ CEDH et écartant une jurisprudence nationale ;
Réponse à la Question N°11.
(a)Marge nationale d’appréciation
Dans son discours prononcé lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire, le 15 janvier 2018, Monsieur Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation a énoncé « La Cour de cassation, vous le savez, est en recherche constante pour mieux occuper le terrain de la marge nationale d’appréciation qui lui permet de faire application pleinement et par elle-même du droit européen. ».
Nous pouvons citer l’exemple de l’affaire du « barème Macron »27. Après différents jugements de conseils de prud’hommes écartant l’application du barème (à Lyon, Grenoble, Angers, Troyes, Amiens, Bordeaux, Agen, Montpellier, …), l’avis de la Cour de cassation sur la conformité du barème aux engagements internationaux de la France était particulièrement attendu. Dans deux affaires portées devant la chambre sociale en formation plénière, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la conventionalité du barème (Pourvois n° 21-14.490 et n° 21-15.247). Sur le fond, la Cour de cassation a jugé les termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne insuffisamment précis pour autoriser une application dans le cadre de litiges individuels.
A l’inverse, l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT est bien, selon elle, doté d’un effet direct en droit national.
Selon ce texte, le juge national doit être habilité à verser « une indemnité adéquate » en cas de licenciement injustifié, cette notion devant être comprise comme « réservant aux Etats une marge d’appréciation ». Pour la Cour de cassation, l’Etat « n’a fait qu’user de cette marge d’appréciation » en fixant un barème permettant au juge d’octroyer au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite de montants minimaux et maximaux.
(b) Reprise de la jurisprudence de la CEDH ou de la CJUE.
Exemples : les arrêts de la chambre sociale en matière de congés payés (Soc. 13 sept. 2013, n°22-17.340 et Soc. 13 septembre 2023, n°22-10.529).
Consulter la lettre de la chambre sociale pour davantage d’informations sur le sujet : https://www.courdecassation.fr/files/files/Publications/Lettre%20de%20chambre/Sociale/N%C2%B021/Cour_de_Cassation_Lettre_de_la_Chambre_sociale%20_n%C2%B0%2021%20_septembre_octobre_2023.pdf
Pour aller plus loin. L’impact du droit européen : dialogue des juges et l’influence extraterritoriale du droit européen
Question N°12. Comme évoqué dans mes propos introductifs l’européanisation est aussi marquée par un mouvement horizontal d’un Etat membre vers un autre. La reprise des jurisprudences des autres Etats membres dans les arrêts illustre parfaitement ce mouvement. Votre juridiction accorde-t-elle une place importante au droit comparé dans sa motivation ?
Réponse à la Question N°12. La Cour de cassation accorde une place importante au droit comparé. La Cour cite notamment dans sa motivation des décisions d’autres Etats.
La motivation des décisions permet ainsi l’intégration pleine et entière de la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE dans les arrêts mais également de la jurisprudence des cours suprêmes étrangères (ex : Ass plénière, 12 mai 2023, pourvois n°22-80.057 et n°22-82.46828).
La référence au droit comparé témoigne de l’influence des pratiques et des techniques de la CEDH sur le juge français de la cassation.
Question N°13. Avez-vous connaissance d’un arrêt de la CEDH ou de la CJUE ou de l’une de vos décisions rendues en application du droit européen qui auraient été reprises par une cour suprême d’un Etat tiers ?
Réponse à la Question N°13. La jurisprudence de la CEDH a été reprise par la Cour suprême des Etats-Unis. C’est le cas dans l’arrêt Lawrence contre Texas du 26 juin 2003. Cette décision concernait l’interdiction des rapports homosexuels dans l’Etat du Texas. La Cour Suprême a cité dans sa décision l’arrêt Dundgeon contre Royaume-Uni du 22 octobre 1981.
La Cour suprême de Canada fait également référence à des décision de la CEDH. Par exemple, dans sa décision Etats-Unis contre Burns de 2001, la Cour suprême du Canada s’est référée à l’arrêt Soering contre Royaume-Uni de 1989. La décision concernait une extradition vers les Etats-Unis qui a été refusée par la Cour suprême du Canada car elle entraînerait des risques réels de traitements inhumains et dégradants. La jurisprudence de la CEDH est également mobilisée dans le domaine de la liberté d’expression ou de la liberté d’association.
La Cour interaméricaine des Droits de l’Homme se réfère également à la jurisprudence de la CEDH. C’était surtout le cas lors des premières années de la Cour. Avec le temps, la Cour interaméricaine fait moins référence aux arrêts de la CEDH.
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a également été amenée à se référer à la jurisprudence de la CEDH. C’est le cas dans la décision Tanganyika Law Society et The Legal And Human Rights Centre contre République Unie de Tanzanie et Reverend Christopher Mtikila contre République Unie de Tanzanie du 22 septembre 2011. La Cour Africaine s’était référée à divers arrêts dont Handyside contre Royaume-Uni (7 décembre 1976), Gillow contre Royaume Uni (24 novembre 1986) ou bien Olsson contre Suède (24 mars 1988). De même que pour la Cour interaméricaine, la Cour Africain est amenée à de moins en moins utiliser la jurisprudence de la CEDH.
III§ Impact normatif
Comment le droit européen s’est-il répercuté sur les règles de droit interne des Etats membres ?
Question N°14. L’européanisation se caractérise par un mouvement vertical allant du haut vers le bas et d’un mouvement vertical allant du bas vers le haut. Ainsi, deux interrogations :
• (a) Pouvez-vous estimer, à l’aune des informations dont vous disposez, le nombre de dispositions nationales ayant une origine européenne ?
• (b) Quels liens le pouvoir législatif entretient avec les institutions européennes ? Par ailleurs, le pouvoir législatif de votre pays collabore-t-il activement avec les institutions européennes dans le processus d’élaboration des normes européennes ?
Réponse à la Question N°14. (a) « 80 % des lois françaises viennent-t-elles de l’Union européenne ? ». Cet argument politique fait généralement référence aux paroles de Jacques Delors, président de la Commission européenne de 1985 à 1995. « Vers l’an 2000, 80% de la législation économique peut-être même fiscale et sociale, sera décidée par les institutions européennes ». En réalité la part des lois françaises d’origine européenne serait plutôt de 20% selon l’institut Jacques Delors (étude datant de 2018). Selon le document, “l’européanisation des lois nationales” diffère selon les domaines dans lesquels l’Union européenne a compétence. Elle dépasserait les 30 % là où l’activité législative européenne est effectivement intense : c’est notamment le cas de l’agriculture ou de l’environnement. En matière de transports, d’énergie ou encore de santé, la fourchette se situerait plutôt entre 20 % et 30 %. Elle tomberait à moins de 20 % dans les domaines du travail, de l’éducation ou de la défense. Et serait par définition nulle sur les secteurs sur lesquels l’Union n’a pas son mot à dire parce qu’ils relèvent de la seule compétence nationale. Exemple : en mars 2023, une seule loi française a permis d’intégrer en droit national des mesures européennes sur la protection des épargnants, l’accessibilité des produits internet ou encore les congés des salariés parents.29.
(b) L’article 88-4 Constitution dispose que « Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. ».
La collaboration entre le pouvoir législatif français et les institutions européennes est active. En effet, dans un Rapport d’information n°487 (2022-2023) sur l’influence du Sénat sur l’élaboration des textes européennes (déposé le 30 mars 2023)30, la commission des affaires européennes a été saisie de 949 textes européens au titre de l'article 88-4 et en a sélectionné 261 qu'elle a examinés de plus près, soit en procédure écrite, soit directement lors de ses réunions.
Ces textes ont fait l'objet de 33 communications, destinées à informer les membres de la commission et, plus largement, le Sénat sur leurs enjeux et leurs perspectives d'adoption.
Par ailleurs, 17 résolutions européennes ont été adoptées par le Sénat.
• Dans plus de 64 % des cas, les positions exprimées par le Sénat dans ces résolutions européennes ont été prises en compte. Onze résolutions européennes ont été prises en compte en totalité ou en majorité au cours des négociations à Bruxelles et/ou dans le texte définitif (règlement ou directive) ;
• 5 résolutions européennes adoptées par le Sénat ont été prises en compte partiellement ;
• Enfin, dans un cas, à savoir la réorientation de la politique agricole commune (PAC) pour assurer l'autonomie alimentaire de l'Union européenne, la position du Sénat n'a pas été suivie lors des négociations européennes, la Commission européenne et le Gouvernement étant soucieux de décliner sans délai le « Pacte vert » dans le domaine agricole.
Question N°15. En droit de l’Union européenne, votre pays transposent-ils totalement l’ensemble des directives européennes et plus généralement accordent-ils sa législation à l’ensemble des normes européennes ? En ce sens, avez-vous connaissance des recours en manquement de la Commission européenne débutés contre votre Etat pour violation du droit de l’Union européenne par une autorité judiciaire ces dernières années (article 258 TFUE) et pour manquement à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive (article 260§3 TFUE) ?
Réponse à la Question N°15. D’une part, la Commission européenne n’a débuté aucune procédure en manquement contre l’Etat français pour violation du droit de l’Union européenne par une autorité judiciaire ces dernières années. D’autre part, de manière plus générale, depuis 2022, seulement 2 recours en manquement ont été introduites devant la CJUE.
Toutefois, la Commission a demandé récemment à la France de se mettre en conformité sur la pollution atmosphérique. En ce sens, la Commission a adressé à la France deux lettres de mise en demeure et lui a donné un délai de deux mois pour répondre aux lettres de mise en demeure et mener la transposition à bien. À défaut, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés :
« Elle a adressé une lettre de mise en demeure complémentaire pour non-exécution de l'arrêt de la Cour du 24 octobre 2019 (C-636/18) relatif au non-respect de la directive sur la qualité de l'air ambiant (directive 2008/50/CE). La CJUE avait jugé que la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive sur la qualité de l'air ambiant, étant donné que la valeur limite annuelle de NO2 avait été systématiquement dépassée dans 12 zones de qualité de l'air et la valeur limite journalière de NO2 l'avait été dans deux de ces zones, depuis 2010. Toutefois, la France ne s'est toujours pas conformée à l'arrêt de la CJUE en ce qui concerne les valeurs limites annuelles de NO2 dans quatre zones de mesure de la qualité de l'air : Paris, Lyon, Strasbourg et Marseille-Aix. La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser une lettre de mise en demeure pour transposition incorrecte de la directive sur le crédit hypothécaire (directive 2014/17/UE). La directive sur le crédit hypothécaire vise à créer un marché unique efficient et concurrentiel pour les consommateurs, les prêteurs et les intermédiaires de crédit, assorti d'un niveau élevé de protection des consommateurs, dans le domaine du crédit hypothécaire. La Commission considère que la France n'a pas transposé correctement les aspects de celle-ci relatifs à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement des intermédiaires de crédit établis et agréés dans d'autres États membres. »31.
Question n°16. Lorsque votre juridiction applique du droit dérivé, citez-vous directement la directive (ou davantage la loi de transposition) ? Vous référez-vous aux travaux préparatoires des dispositions européennes dans la motivation de vos décisions (interprétation téléologique) ?
Réponse à la Question n°16. La Cour de cassation mentionne directement dans sa décision les directives européennes lorsqu’elle s’en sert pour interpréter la loi française ou lorsqu’elle en fait directement application. Dans les autres cas, elle ne cite que la loi.
Exemples de cas dans lesquels la Cour de cassation a cité une directive :
• Soc, 3 novembre 2022, n° 20-21.924 : TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de trajet - Temps de déplacement professionnel - Temps dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail - Exclusion - Cas - Travailleur n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel - Déplacements entre le domicile et les sites des clients (référence à la directive)
Extrait de la décision : « 8. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du ''temps de travail'', au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur (CJUE, 10 septembre 2015, Tyco, C-266/14).
9. Certes, ainsi que l'a énoncé l'arrêt précité (points 48 et 49), il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.
10. La Cour de justice considère en outre que la directive ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation d'un État membre, d'une convention collective de travail ou d'une décision d'un employeur qui, aux fins de la rémunération d'un service, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n'est accompli, même lorsque ces périodes doivent être considérées, dans leur intégralité, comme du ''temps de travail'' aux fins de l'application de ladite directive, Radiotelevizija Slovenija (Période d'astreinte dans un lieu reculé), C 344/19, point 58. (CJUE, 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main, C-580/19). »
• Troisième chambre civile, 30 novembre 2022, ° 21-16.40 : La destruction de faucons crécerellettes, espèce protégée, par collision avec des éoliennes, malgré la mise en place de systèmes d'éloignement et en l’absence d’une dérogation prévue par la loi, permet d’engager la responsabilité des exploitants devant le juge civil (référence à la directive).
Extrait de la décision : « 29. A l'instar de ce que prévoit l'article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage (directive « habitats »), l'article 5 de la directive « oiseaux » exige que les Etats membres adoptent un cadre législatif complet et efficace par la mise en oeuvre de mesures concrètes et spécifiques de protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages qui doivent permettre d'assurer le respect effectif des interdictions mentionnées à cet article, notamment l'interdiction de les tuer intentionnellement, l'article 14 autorisant les Etats membres à prendre des mesures plus strictes que celles prévues par cette directive.
30. Les articles L. 411-1 et L. 411-2, 4°, du code de l'environnement interdisent, pour toutes les espèces animales non domestiques protégées, y compris les oiseaux, leur destruction et appliquent les conditions et les motifs de dérogation à ces interdictions posées par l'article 16 de la directive « habitats ». »
Question N°17. Pouvez-vous à la lumière des éléments dont vous disposez, indiquer quels sont les grands arrêts rendus par la CEDH ayant eu un impact jurisprudentiel/normatif sur l’organisation et le fonctionnement de votre système juridique (idée de dialogue tripartites : juge supranational, juge national et législateur) ?
Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à fournir des exemples d’arrêts pris par votre cour en réponse à un arrêt européen ayant conduit à une réforme législative (arrêt de condamnation, arrêts validant vos évolutions législatives, arrêts rendus contre d’autres Etats membres vous ayant impacté, etc.)
Réponse à la Question N°17.
De nombreuses modifications du droit français ont fait suite à une condamnation de la France par la CEDH.
Par exemple, la loi du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques administratives a mis la législation française en conformité avec la Convention européenne des droits de l’Homme, à la suite d’une condamnation de 1990 (arrêts Kruslin et Huvig).
Par exemple, dans l‘arrêt CEDH, du 30 janvier 2020, JMB et a contre France, n°9671/15 relatif au surpeuplement carcéral et aux conditions de détention, la CEDH a considéré que le référé-liberté et le référé mesures-utiles français à la disposition des détenus n’étaient pas effectifs en pratique. La CEDH a ainsi conclu à la violation des articles 3 et 13 de la Convention et a recommandé à la France d’établir un recours préventif et effectif. La Cour de cassation a réceptionné cette décision et a créé de manière prétorienne un recours en ce que « il appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte de ladite décision (CEDH) sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires »32.
Ensuite, le législateur a consacré cette voie de recours par une loi n°2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en prison, publiée au Journal officiel du 9 avril 2021.
Un autre exemple, toute personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure et pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire, à défaut l’article 6 de la Convention est violé (CEDH, 14 octobre 2010, Brusco contre France, 1466/07 ; CEDH 27 oct. 2011, Stojkovic contre France et Belgique, n° 25303/08). Cette obligation tirée de la Convention a d’abord été consacrée par le juge national dans ses quatre arrêts d’assemblée plénière du 15 avril 2011 puis a été consacrée par la loi n°2011-392 relative à la garde à vue.
Enfin, dans l’affaire A.P, Garçon et Nicot contre France (requêtes n°79885/12, 52471/13 et 52596/13) la CEDH a notamment considéré que « le fait de conditionner la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement stérilisant qu’elles ne souhaitent pas subir revenait à conditionner le plein exercice du droit au respect de la vie privée à la renonciation au plein exercice du droit au respect de l’intégrité physique. ». La CEDH a donc conclu à la violation de l’article 8 de la Convention. Toutefois, le régime juridique applicable aux demandes de changement de sexe à l’état civil avait été significativement modifié avant même que l’arrêt de la CEDH ne soit rendu (la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, adoptée le 18 novembre 2016, a créé une procédure spécifique de modification de la mention du sexe à l’état civil) Cette réforme législative paraissait nécessaire dans la mesure où il n’existait jusqu’alors en droit français aucune disposition législative ou règlementaire régissant les demandes de modification de la mention du sexe à l’état civil. La possibilité de déposer de telles demandes résultait néanmoins d’une construction jurisprudentielle, issue de deux arrêts rendus le 11 décembre 1992 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n°91-11900 et 91-12373), adoptés à la suite de la condamnation de la France par la Cour dans l’affaire B. contre France (25 mars 1992, n°13343/87). Il était fait droit à une telle demande lorsque le requérant établissait, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, « la réalité du syndrome transsexuel dont [il est atteint] ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence » (1ère chambre civile, arrêts du 7 juin 2012 et du 13 février 2013). Désormais, le droit interne ne reprend pas la condition jurisprudentielle de l’irréversibilité de la transformation de l’apparence, qui été également censurée par la CEDH postérieurement à l’adoption de la loi du 18 novembre 2016. Cette affaire met en exergue l’évolution des constructions jurisprudentielles de la Cour de cassation.
Question N°18. L’impact du droit européen se traduit également par une idée d’équivalence des dispositions européennes et nationales, notamment constitutionnelles. C’est en ce sens que la CEDH, lorsqu’elle interprète l’obligation pour le requérant de soulever en substance le grief tiré de la violation de la Convention, a notamment admis que les requérants puissent s’appuyer sur des dispositions équivalentes du droit interne (affaire Guberina contre Croatie, 22 mars 2016, n°23682/13)33. La question se pose également du point de vue du juge national. Lors d’un contrôle de conformité d’un acte national transposant le droit de l’Union européenne avec une disposition constitutionnelle qui trouve son équivalent en droit de l’Union européenne, les cours supérieures de votre pays mobilisent-elles la disposition constitutionnelle ou européenne ? Autrement dit, appliquent-t-elles la théorie de l’équivalence des droits dans leur contrôle de conformité ?
Réponse à la Question N°18.
Il existe, dans notre ordre juridique interne français, une certaine équivalence des droits et libertés consacrées par la Constitution et les droits/ principes généraux du droit communautaire. Le Conseil d’Etat s’est ainsi référé à la théorie des droits équivalents dans le contrôle de conformité d’un acte national transposant le droit de l’Union européenne.
Pour rappel, l’article 55 de la Constitution dispose que les traités internationaux possèdent une autorité supérieure à celle de la loi. Néanmoins, cette suprématie ne vaut pas sur les normes constitutionnelles.
Néanmoins, l’article 88-1 de la Constitution contient une obligation de transposition des normes européennes. Ainsi, afin de concilier ces deux articles, le Conseil d’Etat dans une décision Arcelor du 8 février 2007 énonce que le juge administratif, lorsqu’il doit contrôler la constitutionnalité d’un décret transposant une directive européenne, doit dans un premier temps rechercher l’équivalent d’un principe constitutionnel interne en droit européen puis contrôle la conformité de la transposition au regard de ce principe (en cas de difficulté, il peut poser une question préjudicielle à la CJUE) et, à défaut, le juge procède directement au contrôle de constitutionnalité. En l’espèce, il était argué la méconnaissance du principe d’égalité. Or le Conseil d’Etat relève que ce principe possède un équivalente en droit européen (un principe général de droit).
Il est pertinent de relever que la plupart des principes généraux du droit européen sont également inscrits dans la Constitution, ce qui témoigne de l’européanisation du droit.
Cet arrêt met en exergue l’idée d’une équivalence entre un principe constitutionnel et un principe général du droit de l’Union européenne. Ce mode de raisonnement a été étendu au contrôle de conventionalité de la loi lorsqu’est invoquée une méconnaissance, par une directive européenne et par la loi qui en opère la transposition fidèle, de droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces droits étant protégés en droit de l’Union européenne en tant que principes généraux, leur respect doit être assuré, en cas de difficulté sérieuse, par la CJUE (CE, 10 avril 2008, Conseil national des barreaux).
Exemples concrets portant sur des thématiques communes
• Réponse à l’exemple thématique N°1. Quel impact le droit européen a-t-il eu dans votre pays sur la conservation et l’accès aux données de connexion à des fins de lutte contre la criminalité ? En la matière, votre juridiction (ou toute autre judication de votre pays) a-t-telle effectuée un renvoi préjudiciel ? En cas de réponse positive, expliquez l’impact de la décision de la CJUE sur votre système juridique.
Les hautes juridictions françaises ont dû tirer les conséquences en droit interne et les incidences pratiques des arrêts de la CJUE en matière de conservation des données et d’accès à celles-ci. En effet, l’adhésion à l’Union européenne emporte pour le juge national l’obligation d’assurer la primauté du droit de l’Union européenne. Ledit principe de primauté impose donc aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union. Pour cela, le juge a l’obligation d’assurer le plein effet des dispositions du droit de l’Union en laissant inappliqué, de sa propre autorité, toute disposition contraire dans la législation nationale (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77).
La réception de la jurisprudence de la CJUE par les hautes juridictions françaises
(i) Le Conseil d’Etat34
L’arrêt du 6 octobre 2020 La Quadrature du Net e.a (C-511/18), French Data Network e.a (C-512/18) ainsi qu’Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C-520/18) a notamment été rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel formulé par le Conseil d’Etat français.
Dans son arrêt du 21 avril 2021 (req. N°393099), le Conseil d’Etat statuant en Assemblée plénière, réceptionne l’arrêt de la CJUE faisant suite à sa demande de renvoi préjudiciel. Le Conseil d’Etat commence par rappeler que la Constitution française demeure la norme suprême du droit national. Ainsi, il lui revient de vérifier que l’application du droit européen (directive ou règlement), tel que précisé par la CJUE, ne compromet pas en pratique des exigences constitutionnelles qui ne sont pas garanties de façon équivalente par le droit européen (ici on retrouve la théorie des droits équivalents mentionnée à la question n°18 du questionnaire). Le Conseil d’État constate que les exigences constitutionnelles que sont la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l’ordre public, la lutte contre le terrorisme et la recherche des auteurs d’infractions pénales ne bénéficient pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente à celle que garantit la Constitution.
Pour autant, le Conseil d’Etat n’active pas la clause de sauvegarde. Il relève que la conservation généralisée aujourd’hui imposée aux opérateurs par le droit français est bien justifiée par une menace pour la sécurité nationale, comme cela est requis par la CJUE. En effet, depuis 2015 la France est confrontée au terrorisme mais aussi au risque d’espionnage et d’ingérence étrangère ainsi qu’à des menaces graves pour la paix publique. Conformément aux exigences de la Cour, il impose au Gouvernement de procéder, sous le contrôle du juge administratif, à un réexamen périodique de l’existence d’une telle menace.
En revanche, il juge illégale l’obligation de conservation généralisée des données (hormis les données peu sensibles : état civil, adresse IP, comptes et paiements) pour les besoins autres que ceux de la sécurité nationale, notamment la poursuite des infractions pénales.
Pour ces infractions, la solution suggérée par la CJUE de conservation ciblée en amont des données n’est ni matériellement possible, ni – en tout état de cause – opérationnellement efficace selon lui. En effet, il n’est pas possible de prédéterminer les personnes qui seront impliquées dans une infraction pénale qui n’a pas encore été commise ou le lieu où elle sera commise. Toutefois, la méthode de « conservation rapide » (sur injonction de l’autorité judiciaire) autorisée par le droit européen peut à ce jour s’appuyer sur le stock de données conservées de façon généralisée pour les besoins de la sécurité nationale, et peut être utilisée pour la poursuite des infractions pénales suffisamment graves.
S’agissant de la distinction établie par la Cour entre la criminalité grave et la criminalité ordinaire, pour laquelle elle n’admet aucune conservation ou utilisation de données de connexion, le Conseil d’État rappelle que le principe de proportionnalité entre gravité de l’infraction et importance des mesures d’enquête mises en œuvre, qui gouverne la procédure pénale, justifie également que le recours aux données de connexion soit limité aux poursuites d’infractions d’un degré de gravité suffisant.
S’agissant de l’exploitation des données conservées pour les besoins du renseignement, enfin, le Conseil d’État constate que le contrôle préalable par une autorité indépendante prévu par le cadre juridique français n’est pas suffisant, puisque l’avis que rend la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) avant toute autorisation n’est pas contraignant. Le droit national doit donc être modifié, même si, en pratique, le Premier ministre n’a jamais outrepassé un avis défavorable de la CNCTR pour l’accès des services de renseignement à des données de connexion. Le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de modifier le cadre réglementaire pour respecter ces exigences dans un délai de 6 mois.
(ii) La Cour de cassation (Cass. crim., 12 juill. 2022, no 21-83710 ; Cass. crim., 12 juill. 2022, no 21-83820; Cass. crim., 12 juill. 2022, no 21-84096 ; Cass. crim., 12 juill. 2022, no 20-86652).
La Cour de cassation a rendu quatre décisions, le 12 juillet 2022, relatives à la conservation et l’accès aux données de connexion dans le cadre des enquêtes pénales. Par ces 4 décisions, la chambre criminelle de la Cour réceptionne la jurisprudence de la CJUE en la matière (arrêt du 6 octobre 2020 La Quadrature du Net e.a (C-511/18), French Data Network e.a (C-512/18) ainsi qu’Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C-520/18) & arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur, C-746/18)).
Dans chacune des quatre espèces, les mis en cause demandaient l’annulation de la conservation et de l’exploitation des données de connexion, faites tantôt sur réquisition du procureur, tantôt sur commission rogatoire du juge d’instruction. Ils invoquaient principalement deux arguments. D’une part, ils considéraient que la législation française relative à la conservation des données de connexion était irrégulière, en ce qu’elle concernait toutes les infractions pénales, sans distinction et sans critère de gravité minimale. D’autre part, ils critiquaient les modalités d’accès à ces données de connexion ; un accès autorisé soit par le procureur, soit par le juge d’instruction, lesquels ne seraient pas des juridictions ni des administratives in dépendantes comme l’exige le droit européen.
La chambre criminelle de la Cour de cassation applique le droit de l’Union tel qu’il est interprété par la CJUE.
• Sur la conservation générale des données : Dispositions en cause : article L.34 III35 et R.10-1336 du code des postes et des communications électroniques.
Solution : conformité partielle au droit de l’Union
La conservation de données générale et indifférenciée, pendant une durée limitée est permise par le droit de l’UE. Pour cela, il faut qu’il existe « une menace grave, réelle, actuelle ou prévisible » pour la sécurité nationale (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020 La Quadrature du Net e.a (C-511/18), French Data Network e.a (C-512/18) ainsi qu’Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C-520/18)). Néanmoins, cette menace doit faire l’objet d’un réexamen périodique ce que l’article L.34 III du code des postes et des communications électroniques n’imposaient pas dans la version antérieure à la loi de 2021. Ainsi, la chambre criminelle, dans le dessein de pallier cette lacune, exige du juge du fond, saisi d’une nullité, qu’il constate « sous le contrôle de la Cour de cassation l’existence d’une menace présentant les caractéristiques précités », à la date de la conservation des données. La chambre criminelle retient que cette condition était acquise en l’espèce. Elle juge donc qu’il est possible de conserver de façon généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation pour lutter contre des infractions portant aux intérêts fondamentaux de la nation et actes de terrorisme.
• Sur la conservation rapide des données : articles 60-1, 60-2, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022.
Solution : conformité des dispositions autorisant la conservation rapide
Une fois cette possibilité de conservation acquise, comment ces données peuvent-elles être exploitées dans le cadre d’enquêtes pénales qui comme en l’espèce, n’engageant pas la sécurité nationale ? Tout d’abord, la Cour relève que l’injonction de conservation rapide peut résulter d’une injonction de produire.
Les données de trafic ou de localisation conservées par les opérateurs sont communiquées en raison de réquisitions qui résultent de trois cas : par officier ou agent de police judiciaire en cas d’enquête de flagrance, sur autorisation du procureur en cas d’enquêtes préliminaires ou sur commission rogatoire du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information.
La Cour retient que les dispositions du code de procédure pénale, dans leur version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022, peuvent être interprétées comme conformes au droit de l’Union en ce qu’elles permettent la « lutte contre la criminalité grave, en vue de l’élucidation d’une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockés, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale ». Néanmoins, la criminalité grave n’est pas définie en droit de l’Union. Il appartient en conséquence à la juridiction lorsqu’elle est saisie d’un moyen ou d’une exception de nullité, de vérifier que les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de criminalité grave.
Pour cela, ce critère de la criminalité grave s’analyse au regard de la nature des agissements de la personne poursuivie, du montant du préjudice qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et la durée de la peine encourue.
La chambre criminelle délivre un véritable mode d’emploi aux juges du fond. Au-delà de ces arrêts, le nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale impose désormais, in abstracto, un seuil de gravité : il réserve, sauf exception, ces réquisitions aux infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Enfin, la juridiction doit s’assurer que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l‘accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire.
• Sur l’accessibilité des données : dispositions en cause : articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2 du code de procédure pénale.
Solution : non-conformité des dispositions donnant compétence au procureur de la République pour autoriser l’accès aux données de connexion et conformité de celles qui donnent une telle compétence au juge d’instruction
Comme évoqué précédemment, l’accès aux données ne peut être autorisé que s’il est soumis au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante (Cf. CJUE, affaire Prokuratuur). La chambre criminelle s’est alignée sur la jurisprudence de la CJUE
En l’espèce, l’accès aux données de connexion avait été autorisé tantôt par le juge d’instruction tantôt par le procureur.
Toutefois, la chambre criminelle retient que « les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale sont contraires au droit de l’Union uniquement en ce qu’ils ne prévoient pas préalablement à l’accès aux données un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante. En revanche, le juge d’instruction est habilité à contrôler l’accès aux données de connexion ». En effet, le juge d’instruction n’est pas partie à la procédure et n’exerce pas l’action publique. Il est compétent pour effectuer ledit contrôle.
Ainsi, l’accès aux données doit être autorisé par un juge et non par le procureur.
Bilan : il revient à la Cour de cassation, de tirer les incidences pratiques de cette non-conformité (en vertu du principe d’autonomie procédural). Il s’agit d’une nullité d’ordre privé. Le mis en cause devra avoir intérêt à demander l’annulation, avoir la qualité pour le faire et invoquer un grief. En matière de données de connexion, cela signifie qu’il devra être titulaire ou utilisateur de l’une des lignes identifiées ou établir qu’il aurait été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion des investigations litigieuses. La chambre criminelle ajoute que « l’absence de contrôle indépendant préalable ne peut faire grief au requérant que s’il établit l’existence d’une ingérence injustifiée dans sa vie privée et dans ses données à caractère personnel, de sorte que cet accès aurait dû être prohibé ».
***
Conclusion : L’Union européenne accorde une protection importante à la protection des données personnelles au nom de la protection de la vie privée, et limite les ingérences. La réglementation européenne et la jurisprudence de la CJUE ont été réceptionnées par la Cour de cassation et ont impacté le système juridique français en ce que désormais, en pratique, seulement le juge d’instruction autorise de l’accès aux données, les procureurs doivent faire des réquisitions écrites et motivées mais encore l’anonymisation des décisions de justice notamment à l’aune de l’Open Data des décisions judiciaires françaises (RGPD)…
Impact normatif : par exemple la loi 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a réformé le cadre de la conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs est réformé. La loi tire les conséquences de la décision « French Data Network » du Conseil d’État du 21 avril 2021.
Actualité : rapport d’information du Sénat « Surveiller pour punir ? Pour une réforme de l’accès aux données de connexion dans l’enquête pénale ».
Lien : Surveiller pour punir ? Pour une réforme de l'accès aux données de connexion dans l'enquête pénale - Sénat (senat.fr)
• Réponse à l’exemple thématique N°2. Prenez-vous en compte le droit de l’Union européenne et le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme lorsque vous connaissez de contentieux environnementaux et climatiques ? Est-il pertinent dans l’étude de ces questions ?
La Cour de cassation, en sa qualité de plus haute instance de l'ordre judiciaire en France, illustre l'intégration poussée du droit de l'Union européenne (UE) et du droit de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention) dans le cadre juridique national, notamment dans le domaine du contentieux environnemental et climatique. Cette démarche d'intégration se traduit par une jurisprudence qui s'aligne sur les principes et les standards établis au niveau européen, en s'appuyant sur des références précises aux actes et décisions européennes. La tendance est plus marquée en matière environnementale que climatique, car la plupart de ces derniers contentieux sont portés devant l’ordre administratif.
Intégration du droit de l'UE dans la jurisprudence française
Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats) : La Cour de cassation a appliqué directement les dispositions de cette directive dans plusieurs de ses décisions, veillant à ce que les projets d'aménagement respectent les critères de protection des habitats naturels. Par exemple, dans une affaire concernant l'installation d'éoliennes et leur impact sur des espèces protégées, la Cour a insisté sur l'obligation d'évaluation préalable détaillée, conformément à l'article 6 de la Directive Habitats.
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (Directive-cadre sur l'eau): Cette directive a été au cœur de peu de litiges en France, mais d’une affaire portée devant la Cour de cassation dans une affaire qui a soulevé des questions de pollution aquatique par des effluents industriels (Chambre commerciale, 27 mai 2015, 13-15.934).
Intégration de la Convention dans la jurisprudence française
La Cour de cassation et d'autres juridictions françaises ont fait référence à la Convention, en particulier à son article 8 qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, dans le contexte de la protection environnementale.
Article 8 de la Convention et la JP afférente : l’influence de la jurisprudence de la CEDH est indéniable. Les principes dégagés par la CEDH, notamment dans des affaires telles que Dubetska et autres contre Ukraine (requête n° 30499/03), bien que non françaises, constituent des exemples qui orientent la manière dont les droits environnementaux sont appréhendés dans le cadre juridique français.
Dialogue avec les cours européennes
La Cour de cassation engage régulièrement un dialogue avec la CJUE à travers la procédure de question préjudicielle, ce qui permet de clarifier l'application du droit de l'UE dans le contexte français. Ces demandes sont cruciales pour résoudre les questions d'interprétation du droit de l'UE, assurant l'uniformité de son application à travers les États membres.
En droit administratif, relevant en France du Conseil d'État, ce dernier joue un rôle crucial dans l'intégration du droit européen, en veillant à ce que les normes et directives de l'UE, ainsi que les principes de la Convention, soient respectés par les autorités administratives françaises.
Ainsi, dans l’affaire « Grande-Synthe » (Conseil d'État, 19 novembre 2020, n° 427301), le Conseil d'État a ordonné au gouvernement français de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux engagements internationaux de la France. Cette affaire illustre comment le Conseil d'État applique les principes du droit international et européen, en l'occurrence l'Accord de Paris sur le climat, pour influencer la politique environnementale française. Cette décision montre également l'interaction entre le droit administratif et les engagements internationaux et européens de la France en matière d'environnement.
• Réponse à l’exemple thématique N°3.
Première réponse : En matière pénale, ddans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, et si cela a déjà été le cas, vos juridictions ont-elles rendu des décisions écartant le principe de confiance mutuelle afin de prévenir une atteinte aux droits fondamentaux ?
Au début de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen (MAE), la Cour de cassation avait une application très stricte du principe de confiance mutuelle, même si les droits fondamentaux étaient invoqués par le requérant au pourvoi37. En effet, le MAE étant un mécanisme de coopération pénale internationale, toutes les causes de refus d’exécution d’un tel mandat doivent impérativement être prévues par les instruments juridiques et transposés en droit national. Néanmoins, les droits fondamentaux du fait de leur valeur occupent une place particulière.
En ce sens, la Cour de cassation s’est mise à prendre en compte les droits fondamentaux dans l’analyse des demandes de remise sur MAE. Ainsi, la chambre criminelle a commencé par demander aux chambres de l'instruction de s'assurer auprès de l'État d'émission, par le biais de l'article 695-33 du Code de procédure pénale, que celui-ci ne remettra pas la personne recherchée à l'État dans lequel elle encourt des risques de violation de ses droits fondamentaux38. Par exemple, dans l’arrêt du 7 février 200739, le requérant, d’origine iranienne, craignait d’être renvoyé en Iran après avoir exécuté sa peine au Portugal. Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt la chambre d’instruction en ce « qu'en se déterminant ainsi, sans faire application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale qui permettait aux juges de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l'intéressé à l'issue de sa peine au regard notamment des dispositions tant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 auxquels la France et le Portugal sont parties, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision. ». Cette demande d’informations complémentaires est un moyen de contrôle, notamment au regard des droits fondamentaux.
De plus, en 2005, la Cour a refusé l’exécution de MAE sur un fondement procédural (art. 593 CPP) mais également du fait du droit à la vie privée (sans pour autant citer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales) : Crim. 26 oct. 2005, no 05-85.847 , Bull. crim. no 270.
La Cour de cassation a reproché en 2010 à une chambre de l'instruction d'avoir décidé de l'exécution d'un MAE à l'encontre d'une mère installée avec ses cinq enfants en France sans vérifier si la remise de cette personne ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la Convention (Crim. 12 mai 2010, no 10-82.746, Bull. crim. no 86). Cet arrêt a ouvert la voie à la possibilité, en dehors des cas prévus par la décision cadre, d’invoquer l’atteinte au respect la vie et familiale pour s’opposer à l’exécution d’un MAE.
Si la Cour n’a pas écarté le principe de confiance mutuelle dans l’un de ses arrêts, elle peut parfois effectuer un certain contrôle du respect des droits fondamentaux, notamment dans les quatre domaines suivants :
• La protection contre la torture et traitements inhumains et dégradants : ex : Crim. 9 juin 2015, no 15-82.750 ou Crim. 7 août 2013, no 13-85.076 – Crim. 20 mai 2014, no 14-83.138 , Bull. crim. no 135 – Crim. 12 juill. 2016, no 16-84.000 ;
• La protection de la vie privée et familiale : elle oblige si nécessaire les chambres de l'instruction à statuer sur le caractère éventuellement disproportionné d'une atteinte à ce droit même si une disposition légale qui est propre à le faire respecter, tel l'article 695-24, 2o, du code de procédure pénale, a été dûment mise en œuvre (Crim. 12 avr. 2016, no 16-82.175 : la chambre criminelle décide de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt au Pays Bas au motif du respect de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article 8 Convention) ;
• La protection des droits de la défense : ex : Crim. 12 juill. 2016, no 16-84.000 : dans cet arrêt la chambre criminelle effectue un contrôle sur le fondement des droits de la défense dans le procès mené en Roumanie et entend vérifier l’absence de risque de traitements inhumains et dégradants ;
• La protection du principe de légalité des délits et des peines : la chambre criminelle de la Cour de cassation procède au contrôle du respect par la chambre de l'instruction du principe de légalité et des peines, affirmant que « la Common Law constitue une source de droit répondant aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi d'incrimination et des peines » (Crim. 27 juill. 2016, no 16-84.592)
La Cour n’a ainsi jamais refusé la remise sur le fondement du respect des droits fondamentaux en écartant formellement le principe de confiance mutuelle. Toutefois, elle opère un contrôle dans ces quatre domaines susmentionnés.
Réponses aux questions suivantes : Votre Etat a-t-il adopté des peines plus sévères que les peines maximales ou minimales imposées par le droit de l’Union ? Si tel est le cas, dans quels domaines ? Outre les infractions liées aux intérêts financiers de l’Union, vos Etats ont-ils été amenés à créer de nouvelles infractions à la suite d’une directive européenne ?
Enfin, le mandat d’arrêt européen a permis aux Etats membres de simplifier l’extradition au sein de l’Union, avez-vous modifié le quantum de certaines peines afin d’élargir le nombre d’infractions permettant l’utilisation du mandat d’arrêt européen ?
Pour la majorité des infractions, les peines étaient déjà plus sévères que celles exigées par les directives. Par exemple, la directive 2004/757/JAI concernant le trafic de stupéfiants indique que la production d’une grande quantité de stupéfiants doit être sanctionnée d’une peine d’au moins cinq à dix ans d’emprisonnement. La France, a prévu cette infraction à l’article 222-35 du code pénal depuis de nombreuses années qui est sanctionnée d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle.
Ensuite, dans les cas où la peine a dû être rehaussée ou dans les cas où une infraction a été créée à la suite d’une directive, les peines françaises sont généralement plus sévères que celles exigées par la directive. Cela est dû à la spécificité des peines en France. En effet, en vertu de l’article 131-1 du code pénal, les peines criminelles sont la détention criminelle à perpétuité, la détention criminelle de trente, vingt, quinze ou dix ans. L’article 131-3 du code pénal dispose que les peines d’emprisonnement correctionnel sont de dix, sept, cinq, trois, deux ou un an ou bien de six ou deux mois. De ce fait, il n’est pas possible de prévoir une peine d’emprisonnement se situant entre l’un de ces paliers. Ainsi, la directive 2014/57/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché exige que les infractions d’initié soient sanctionnées d’une peine maximale d’au moins 4 ans. Cette infraction, prévue à l’article L465-1 du code monétaire et financier, était sanctionnée par une peine de deux ans d’emprisonnement. En transposant la directive, la peine encourue ne pouvait pas être de quatre ans d’emprisonnement. La peine a donc été fixée à cinq ans d’emprisonnement qui correspond au pallier supérieur au sein de l’échelle des peines d’emprisonnement en France.
Finalement, peu de dispositions pénales françaises prévoient une peine maximale encourue égale au minimum de la peine maximale exigée par les directives. Les peines françaises sont globalement plus sévères que celles prévues par les directives.
L’Union européenne a joué un rôle créateur dans le droit pénal substantiel. Ce rôle n’est cependant pas le même en fonction des domaines. A titre d’exemple, la directive 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme n’a pas eu d’impact sur le droit pénal français dans la mesure où le droit pénal sanctionnait déjà l’ensemble des infractions listées dans la directive.
Cependant, la loi pénale française a adopté de nouvelles dispositions dans d’autres domaines. Elle a par exemple ajouté le prélèvement d’organes au sein des dispositions relatives au trafic d’êtres humains suite à la directive 2011/36/UE 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.
Suite à la directive 2011/93 du 13 décembre 2011 sur la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, l’article 222-22-2 du code pénal a ajouté qu’une agression sexuelle pouvait également être le fait d’imposer à une personne de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers.
L’Union Européenne a également amené à la France à sanctionner des tentatives d’infraction qui ne l’étaient pas auparavant. C’est le cas de la tentative de consulter des sites pédophiles ou de la tentative d’atteintes sexuelles par exemple.
Enfin, concernant le mandat d’arrêt européen, la France n’a pas modifié le quantum des peines afin de pouvoir faciliter le recours à ce dispositif.
NETWORK OF THE PRESIDENTS OF THE SUPREME JUDICIAL COURTS
OF THE EUROPEAN UNION
CONFERENCE OF THE NETWORK
3–4 OCTOBER 2024
ATHENS, GREECE
“Attractiveness of the Judiciary”
QUESTIONNAIRE
Established by
Mr Petr Angyalossy
President of the Supreme Court of the Czech Republic
Ms Danguolė Bublienė
President of the Supreme Court of Lithuania
Mr Miodrag Đorđević
President of the Supreme Court of Slovenia
PART I
ATTRACTIVENESS OF THE JUDICIARY TO JUDGES
1. Remuneration
1.1. How are judges’ salaries determined? What factors influence the amount of judges' salaries (e.g., length of service, inflation)? Please specify.
1.2. What is the starting gross salary of a:
1.2.1. first instance judge?
1.2.2. Supreme Court judge?
1.3. What is the ratio between the starting gross salary in 1.2 and the average salary:
1.3.1. in your country?
1.3.2. of other comparable legal professions (e.g., attorneys, notaries)?
1.4. What is the ratio between the starting salary in 1.2 and the starting salaries of members of parliament and ministers?
1.5. Is there a rule in your country according to which judges’ salaries are raised or lowered based on the budgetary possibilities of the state, economic growth, or inflation? Please specify.
1.6. Has the Constitutional Court ever ruled on the constitutionality of judges' salaries?
1.7. Is there any discussion about the possibility of “freezing” judges’ salaries? Has it ever occurred? Were there any constitutional problems with such a decision?
1.8. Has there been a debate (among legal professionals, the public or at the legislator level) about possible changes to the current system or the amount of judges' remuneration?
2. Other Material/Non-Material Benefits
2.1. Please indicate (“X”) the benefits applicable to your country:
Benefits
First instance judges
Supreme Court judges
Accommodation (e.g. apartment)
Accommodation allowance
Meal allowance
More than the legally prescribed number of vacation days
Sabbatical
Sick time (outside health insurance system)
Study leave
Working from home
Day care for children provided by the court
Provision of official court vehicle
Telephone, laptop
Language courses
Other educational courses
Salary supplements due to incompatibilities and prohibitions concerning other posts/activities
Others (please specify):
2.2. Do judges' benefits correspond to benefits applied to the public sector in general or are they special benefits for judges?
2.3. Is there a public discussion around these issues? Are some of the benefits subject to criticism as inappropriate expenditure of public funds?
3. Guarantees, Health and Social Security
3.1. Do judges make the same percentage contributions as others to the health and social security system)? Are all parts of their remuneration used as the basis for calculating their health and social insurance contributions?
3.2. What is the maternity/paternity/parental leave system in your country? Are there any special advantages/disadvantages for judges?
3.3. What impact does the use of the benefits in 3.2 have on the future career development of judges? Is one gender influenced by this more than another (e.g. is it possible to automatically return to the pre-existing position; does this time count towards the financial calculation; can the use of these benefits by judges be disadvantageous in relation to their career development)? Please specify.
3.4. Is there a mandatory retirement age for judges in your country?
3.4.1. If the answer is yes:
3.4.1.1. At what age must judges retire?
3.4.1.2. What are the consequences of reaching the statutory retirement age (e.g. loss of judicial status)? Please specify.
3.4.2. Is there any debate regarding the mandatory retirement age?
3.4.3. Is there a mandatory retirement age for Constitutional Court judges (where a separate Constitutional Court exists)?
3.5. Do you have “emeritus” judges (e.g. legislation allowing older judges to remain partly within the judiciary)?
3.5.1. If the answer is yes:
3.5.1.1. Please specify how this functions.
3.5.1.2. What is the financial and other remuneration of emeritus judges, both in service and outside of the active performance of duties?
3.5.1.3. Are there any debates regarding the institution of emeritus judges?
3.6. How are judges' pensions determined? Are there special rules for calculating their amount?
3.7. Are there any additional social security or health insurance benefits for judges?
3.8. What budget (in addition to EJTN funding) is allocated to the training of judges?
4. Special Obligations of a Judge
4.1. What activities are allowed, partially allowed or prohibited for judges? Please indicate (”X”). If the answer is “Partially allowed” please specify.
Activities
Allowed
Partially allowed
Prohibited
Additional employment
Involvement in management or supervisory boards of commercial companies
Possibilities of self-employment/entrepreneurship
Membership in the government
Membership of legislative bodies (including committees and commissions)
Political participation (including regional/local government)
Membership of labour unions
Taking part in a strike
Artistic activities
Professional sports activities
Publishing and lecturing activities
Others (please specify):
4.2. Is it transparently set out (in the code of ethics, case law or legislation) which activities are considered to undermine the dignity of judicial office? Please specify.
4.3. Do judges have to obtain security clearance?
4.4. Are judges obliged to consent to being included in special lists (e.g. former or current membership of a political organization)? If the answer is yes, please specify.
4.5. Do judges have a duty to provide detailed information about their assets? Is such information on judges' assets publicly available or available on request?
4.6. Are there any other mandatory declarations/personal disclosures for judges, for example concerning the reconciliation (balancing) of public and private interests? Are such declarations publicly available?
4.7. Does a judge have to subject himself/herself to an evaluation of his/her performance (compliance with deadlines, number of resolved cases, compliance with case law of higher courts, etc.)? Please specify.
4.7.1. Are judges' attitudes towards evaluation procedures positive (i.e. contributing to attractiveness) or negative (i.e. contributing to unattractiveness)?
4.8. Are judges entrusted with special duties in the electoral process in your country?
4.9. Is there discussion in the public domain concerning changes to the regulation in this regard?
5. Selection and Promotion Procedures
5.1. What are the statutory conditions for becoming a judge? Please specify.
5.2. What is the procedure for becoming a judge (e.g. passing a judicial exam, who proposes candidates, who approves candidates)? Please specify.
5.3. What is the average age of newly elected/appointed judges? Is it different than 5 or 10 years ago?
5.4. Are judges leaving office more frequently than in the past few years?
5.5. Please indicate (“X”) whether the selection procedure to become a judge is:
Yes
No
Not clear
Prompt
Transparent (i.e, objective statutory criteria apply)
Unified (i.e. same for all courts and instances)
5.5.1. If the answer is no or not clear, please elaborate on the reasons for this answer.
5.6. Does the selection procedure ensure diversity of:
5.6.1. Candidates?
5.6.2. Judges?
5.7. What is the ratio of men to women in:
Men
Women
Local (district) courts
Regional courts
High courts
Supreme Court
5.7.1. If your court system has more instances, please specify.
5.8. What are the conditions in order to:
5.8.1. be promoted to a higher instance court?
5.8.2. hold a court office (e.g. president of a panel/division)?
5.8.3. become the president of a court?
5.9. What is the promotion procedure (e.g., who proposes promotion, who approves the candidates)?
5.10. Please indicate (“X”) whether the promotion procedure is:
Yes
No
Not Clear
Prompt
Transparent (i.e. objective statutory criteria apply)
Unified (i.e. same for all courts and instances)
5.10.1. If the answer is no or not clear, please elaborate on the reasons for this answer.
5.11. Does the promotion procedure ensure diversity of candidates?
5.12. What is the ratio of men to women holding the office of:
Men
Women
President of a local (district) court
President of a regional court
President of a high court
5.12.1. If your court system has more instances, please specify.
6. Summary Questions
6.1. Has there been any research in your country to assess the prestige/social status of judges among the general public?
6.2. Are any special measures used to increase attractiveness, such as human resource management?
6.3. Are surveys of law students conducted regarding their interest in choosing the profession of judge?
6.4. Does the judiciary in your country experience a lack of candidates interested in becoming a judge?
6.5. Are you experiencing a lack of judges that would affect the functioning of the judiciary?
6.5.1. Are there any vacant judicial posts in your country due to the lack of interest or unsuitability of candidates?
6.6. Please indicate (“X”) how the following factors, in your view, affect the attractiveness of the judiciary for those interested in becoming a judge.
Highly negative
Rather negative
Neutral
Rather positive
Highly positive
Ethical standards
Limitations on secondary activities of judges
Prestige
Promotion procedure
Remuneration
Retirement policy
Selection procedure
Social and health benefits
RÉSEAU DES PRÉSIDENTS DES COURS SUPRÊMES JUDICIAIRES
DE L’UNION EUROPÉENNE
CONFÉRENCE DU RÉSEAU
3–4 OCTOBRE 2024
ATHÈNES, GRÈCE
« L’attractivité du système judiciaire »
QUESTIONNAIRE
Etabli par
M. Petr Angyalossy
Président de la Cour suprême de la République tchèque
Mme Danguolė Bublienė
Présidente de la Cour suprême de Lituanie
M. Miodrag Đorđević
Président de le Cour suprême de Slovénie
PARTIE I
L’ATTRACTIVITÉ DU SYSTÈME JUDICIAIRE POUR LES JUGES
1. Rémunération
1.1. Comment sont déterminés les salaires des juges ? Quels facteurs influencent les montants salariaux des juges (par exemple ancienneté dans le service, inflation) ? Merci de détailler.
1.2. Quel est le salaire brut initial d’un :
1.2.1. juge dans un tribunal d’instance ?
1.2.2. juge à la Cour suprême ?
1.3. Quel est le ratio entre le salaire brut initial indiqué en 1.2 et le salaire moyen :
1.3.1. dans votre pays ?
1.3.2. par rapport à d’autres professions juridiques comparables (par exemple avocats, notaires) ?
1.4. Quel est le ratio entre le salaire initial indiqué en 1.2 et le salaire initial des membres du Parlement ou des ministres ?
1.5. Existe-t-il, dans votre pays, une règle prévoyant que les salaires des juges sont augmentés ou diminués en fonction des disponibilités budgétaires de l’État, de la croissance économique ou de l’inflation ? Merci de détailler.
1.6. La Cour constitutionnelle s’est-elle déjà prononcée sur la constitutionnalité des salaires des juges ?
1.7. Y a-t-il des discussions sur la possibilité de « geler » les salaires des juges ? Le cas s’est-il déjà présenté ? Une telle décision a-t-elle soulevé des problèmes constitutionnels ?
1.8. Y a-t-il eu débat (parmi les professionnels du droit, au sein du public ou au niveau du législateur) sur de possibles modifications au système actuel de rémunération des juges ou au montant de leur rémunération ?
2. Autres avantages matériels/non matériels
2.1. Merci d’indiquer (« X ») les avantages existant dans votre pays :
Avantages
Juges de tribunal d’instance
Juges de la Cour suprême
Logement (par exemple appartement)
Indemnité de logement
Indemnité alimentaire
Nombre de jours de congés au-delà de la durée légalement prescrite
Congés sabbatiques
Absences pour raisons de santé (hors système d’assurance santé)
Congés d’études
Télétravail
Garderie pour les enfants fournie par le tribunal
Voiture de fonction
Téléphone, ordinateur portable
Cours de langues
Autres formations
Suppléments de salaire pour cause d’incompatibilités ou d’interdits concernant d’autres postes/activités
Autres (merci de préciser) :
2.2. Les avantages dont bénéficient les juges sont-ils équivalents à ceux des agents du secteur public en général ou sont-ils spécifiques aux juges ?
2.3. Existe-t-il un débat public autour de ces questions ? Certains de ces avantages sont-ils considérés comme une utilisation inappropriée des deniers publics ?
3. Garanties, santé et sécurité sociale
3.1. La contribution des juges au système de santé et de sécurité sociale est-elle équivalente à celle des autres, en termes de pourcentage du salaire ? Leurs contributions au système de santé et de sécurité sociale sont-elles calculées sur la totalité de leur rémunération ?
3.2. Décrivez le système de congés maternels/paternels/parentaux dans votre pays. Les juges ont-ils des avantages/désavantages particuliers ?
3.3. Quel impact peut avoir le fait de profiter des avantages décrits au point 3.2 sur le développement de la carrière future des juges ? Un sexe est-il plus exposé que l’autre à cet impact (par exemple, est-il possible de retrouver automatiquement sa position antérieure ; la durée du congé a-t-elle une influence sur les calculs financiers ; profiter de ces avantages peut-il s’avérer désavantageux pour un juge, en termes de développement de carrière) ? Merci de détailler.
3.4. Y a-t-il dans votre pays un âge de départ obligatoire à la retraite pour les juges ?
3.4.1. En cas de réponse positive :
3.4.1.1. À quel âge les juges doivent-ils prendre leur retraite ?
3.4.1.2. Quelles sont les conséquences de l’arrivée à l’âge légal de retraite (par exemple perte de statut judiciaire) ? Merci de détailler.
3.4.2. L’âge de départ obligatoire à la retraite fait-il l’objet d’un débat ?
3.4.3. Y a-t-il un âge de départ obligatoire à la retraite pour les juges de la Cour constitutionnelle (en cas d’existence d’une Cour constitutionnelle séparée) ?
3.5. Avez-vous des juges « honoraires » ou « émérites » (c’est-à-dire une législation permettant aux juges plus âgés de demeurer partiellement au sein du système judiciaire) ?
3.5.1. En cas de réponse positive :
3.5.1.1. Décrivez le fonctionnement de ce système.
3.5.1.2. Quel est le système de rémunération ou autres avantages appliqué aux juges honoraires, en service et en dehors de l’exercice actif de leur charge ?
3.5.1.3. Le système des juges honoraires fait-il l’objet d’un débat ?
3.6. Comment sont déterminées les pensions de retraite des juges ? Le calcul de leur montant suit-il des règles particulières ?
3.7. Les juges bénéficient-ils d’avantages particuliers en termes de sécurité sociale ou d’assurance santé ?
3.8. Quel budget (venant s’ajouter au financement par le REFJ) est consacré à la formation des juges ?
4. Obligations particulières d’un juge
4.1. Quelles activités sont autorisées, partiellement autorisées ou interdites pour les juges ?
Merci d’indiquer votre réponse par le signe « X ». Si la réponse est « partiellement autorisée », merci de détailler.
Activités
Autorisée
Partiellement autorisée
Interdite
Emploi supplémentaire
Participation au conseil d’administration ou au conseil de surveillance
d’entreprises commerciales
Possibilité d’auto-entrepreneuriat
Appartenance au gouvernement
Appartenance aux organes législatifs (y compris comités et commissions)
Participation politique (y compris autorités régionales/locales)
Appartenance à des syndicats
Participation à une grève
Activités artistiques
Activités sportives professionnelles
Publications ou conférences
Autres (merci de détailler) :
4.2. Les activités considérées comme compromettant la dignité de la fonction de juge sont-elles spécifiées de façon claire (dans le code déontologique, la jurisprudence ou la législation) ? Merci de détailler.
4.3. Les juges doivent-ils obtenir une habilitation de sécurité ?
4.4. Les juges sont-ils obligés d’accepter leur inclusion dans des listes spéciales (par exemple appartenance passée ou présente à une organisation politique) ? Si la réponse est oui, merci de détailler.
4.5. Les juges sont-ils tenus de fournir des informations détaillées sur leur patrimoine ? Ces informations sur le patrimoine des juges sont-elles publiques ou accessibles sur demande ?
4.6. Existent-ils d’autres déclarations obligatoires/communications de renseignements personnels pour les juges, par exemple concernant la compatibilité des intérêts publics et privés ? Ces déclarations sont-elles publiées ?
4.7. Un juge doit-il se soumettre à une évaluation de ses performances (respect des délais, nombre d’affaires résolues, respect de la jurisprudence des cours supérieures, etc.) ? Merci de détailler.
4.7.1. L’attitude des juges vis-à-vis des procédures d’évaluation est-elle positive (c’est-à-dire contribuant à l’attractivité de la profession) ou négative (donc diminuant cette attractivité) ?
4.8. Les juges se voient-ils attribuer des responsabilités particulières dans le processus électoral de votre pays ?
4.9. Existe-t-il un débat dans votre pays concernant des modifications aux règles concernant ces questions ?
5. Procédures de sélection et de promotion
5.1. Quelles sont les conditions légales pour devenir juge ? Merci de détailler.
5.2. Quelle est la procédure pour devenir juge (par exemple réussir un examen judiciaire, qui propose les candidats, qui approuve les candidats) ? Merci de détailler.
5.3. Quel est l’âge moyen des juges nouvellement élus/nommés ? A-t-il évolué depuis 5 ou 10 ans ?
5.4. Les juges quittent-ils leur fonction plus fréquemment qu’au cours des dernières années ?
5.5. Merci d’indiquer (« X ») si la procédure de sélection pour devenir juge est :
Oui
Non
Indéterminé
Rapide
Transparente (i.e. application de critères légaux objectifs)
Unifiée (i.e. identique pour tous les tribunaux et instances)
5.5.1. Si la réponse est « Non » ou « Indéterminé », merci de détailler les raisons de votre réponse.
5.6. La procédure de sélection assure-t-elle la diversité des :
5.6.1. Candidats ?
5.6.2. Juges ?
5.7. Quel est la répartition hommes/femmes dans :
Hommes
Femmes
Tribunaux d’instance
Tribunaux de grande instance
Hautes cours
Cour de cassation
5.7.1. Si votre système judiciaire possède plus d’instances, merci de détailler.
5.8. Quelles sont les conditions pour :
5.8.1. être promu à un tribunal d’instance supérieure ?
5.8.2. exercer une responsabilité spécifique dans un tribunal (par exemple, président d’une chambre/division) ?
5.8.3. devenir président d’un tribunal ?
5.9. Quelle est la procédure de promotion (par exemple, qui propose la promotion, qui approuve les candidats) ?
5.10. Merci d’indiquer (« X ») si la procédure de promotion est :
Oui
Non
Indéterminé
Rapide
Transparente (i.e. application de critères légaux objectifs)
Unifiée (i.e. identique pour tous les tribunaux et instances)
5.10.1. Si la réponse est « Non » ou « Indéterminé », merci de détailler les raisons de votre réponse.
5.11. La procédure de sélection assure-t-elle la diversité des candidats ?
5.12. Quel est la répartition hommes/femmes dans la fonction de :
Hommes
Femmes
Président d’un tribunal d’instance
Président d’un tribunal de grande instance
Président d’une Haute cour
5.12.1. Si votre système judiciaire possède plus d’instances, merci de détailler.
6. Questions complémentaires
6.1. Des recherches ont-elles été menées dans votre pays pour évaluer le prestige/statut social des juges aux yeux du grand public ?
6.2. Prend-on des mesures particulières pour accroître l’attractivité, en matière de gestion des ressources humaines par exemple ?
6.3. Conduit-on des études parmi les étudiants en droit pour mesurer leur intérêt pour la carrière de juge ?
6.4. Le système judiciaire de votre pays souffre-t-il d’un manque de candidats intéressés par la profession de juge ?
6.5. Rencontrez-vous une pénurie de juges susceptible d’affecter le fonctionnement de votre système judiciaire ?
6.5.1. Existe-t-il dans votre pays des postes judiciaires vacants en raison d’un manque d’intérêt ou du manque des qualités requises chez les candidats ?
6.6. Merci d’indiquer (« X ») dans quelle mesure les facteurs suivants vous paraissent affecter l’attractivité des professions judiciaires pour les personnes intéressées par la carrière de juge.
Très négatif
Plutôt négatif
Neutre
Plutôt positif
Très positif
Normes déontologiques
Limitations sur les activités annexes des juges
Prestige
Procédure de promotion
Rémunération
Système de retraite
Procédure de sélection
Sécurité sociale et assurance de santé
RÉSEAU DES PRÉSIDENTS DES COURS SUPRÊMES JUDICIAIRES
DE L’UNION EUROPÉENNE
CONFÉRENCE DU RÉSEAU
3–4 OCTOBRE 2024
ATHÈNES, GRÈCE
« L’attractivité du système judiciaire »
QUESTIONNAIRE
Etabli par
M. Petr Angyalossy
Président de la Cour suprême de la République tchèque
Mme Danguolė Bublienė
Présidente de la Cour suprême de Lituanie
M. Miodrag Đorđević
Président de le Cour suprême de Slovénie
PARTIE II
L’ATTRACTIVITÉ DU SYSTÈME JUDICIAIRE POUR LE PERSONNEL DES COURS
Dans le cadre de ce questionnaire :
• On entend par « personnel judiciaire » tous les employés possédant une qualification experte et contribuant aux procédures judiciaires/impliqués dans les décisions (par exemple juges assistants, assistants des juges, conseillers, consultants, Rechtspfleger, référendaires).
• On entend par « personnel administratif » tous les employés non impliqués dans les décisions, comprenant les comptables, sténographes judiciaires, chargés des ressources humaines, spécialistes IT et commis aux dossiers.
• Le « personnel des cours » recouvre les deux catégories ci-dessus.
1. Questions générales
1.1. De combien d’assistants/autres membres du personnel judiciaire dispose un juge (en pratique et selon le nombre de postes formellement approuvés) :
1.1.1. dans un tribunal d’instance ?
1.1.2. à la Cour suprême ?
1.2. Combien y a-t-il de juges, de juges assistants et d’autres membres du personnel judiciaire à la Cour suprême (en pratique et selon le nombre de postes formellement approuvés) ?
1.3. Quelle est la répartition du personnel judiciaire par âge et par sexe ?
2. Rémunération
2.1. Dans votre pays, comment sont fixés les salaires :
2.1.1. du personnel judiciaire ?
2.1.2. du personnel administratif ?
2.1.3. Existe-t-il une dépendance entre les salaires du personnel judiciaire et ceux des juges ?
2.2. La détermination varie-t-elle en fonction des diverses instances des tribunaux ?
2.3. Veuillez indiquer le salaire brut initial et le salaire avec dix ans d’ancienneté des membres du personnel judiciaire (selon votre organisation nationale) dans :
2.3.1. les tribunaux d’instance
2.3.2. la Cour suprême.
2.4. Veuillez indiquer le salaire brut initial et le salaire avec dix ans d’ancienneté des catégories suivantes de personnel administratif dans les tribunaux :
Salaire initial
Salaire après 10 ans
Comptable
Sténographe judiciaire
Chargé des ressources humaines
Spécialiste IT
Commis aux dossiers
2.5. Existe-t-il une différence entre la détermination de la rémunération des employés des tribunaux et celle des autres employés de la fonction publique ?
2.6. Quelle est le rapport entre les salaires initiaux pour :
2.6.1. le personnel judiciaire dans un tribunal d’instance et le salaire moyen dans votre pays ?
2.6.2. le personnel judiciaire à la Cour suprême et le salaire moyen dans votre pays ?
2.6.3. le personnel administratif dans un tribunal d’instance et le salaire moyen dans votre pays ?
2.6.4. le personnel administratif à la Cour suprême et le salaire moyen dans votre pays ?
2.7. La rémunération des employés des tribunaux fait-elle actuellement l’objet d’un débat dans votre pays ?
3. Autres avantages matériels ou non matériels
3.1. Veuillez indiquer (« X ») si un ou plusieurs des avantages matériels ou non matériels suivants sont accordés aux employés des tribunaux :
Personnel judiciaire, tribunal d’instance
Personnel judiciaire, Cour suprême
Personnel administratif, tribunal d’instance
Personnel administratif, Cour suprême
Logement (par exemple appartement)
Indemnité de logement
Indemnité alimentaire
Nombre de jours de congés au-delà de la durée légalement prescrite
Congés sabbatiques
Absences pour raisons de santé (hors système d’assurance santé)
Congés d’études
Télétravail
Contribution supplémentaire aux cotisations de retraite
Contribution financière pour événements culturels (théâtre, etc.)
Contribution financière pour activités sportives
Contribution financière pour vacances
Cafétéria du tribunal
Garderie pour les enfants fournie par le tribunal
Téléphone, ordinateur portable
Cours de langues
Autres formations
Autres (merci de détailler) :
3.2. Y a-t-il actuellement un débat public autour de ces questions (par exemple étendue de ces avantages, leur coût, etc.) ? Si oui, merci de détailler.
4. Obligations particulières
4.1. Des obligations particulières sont-elles imposées aux employés du tribunal (par exemple confidentialité, interdiction d’exercer des activités annexes) ? Merci de préciser.
5. Procédures de sélection et de promotion
5.1. Quelles obligations les candidats doivent-ils remplir (par exemple diplôme dans un domaine spécialisé, durée de la pratique déjà acquise) ? Merci de détailler :
5.1.1. dans le cas du personnel judiciaire
5.1.2. dans le cas du personnel administratif.
5.2. Quelle est la procédure de sélection pour :
5.2.1. le personnel judiciaire ?
5.2.2. le personnel administratif ?
5.3. La procédure de sélection assure-t-elle la diversité :
5.3.1. des candidats ?
5.3.2. des employés des tribunaux ?
5.4. Être un membre du personnel judiciaire est-il une condition ou un avantage pour devenir juge ? Merci de détailler.
5.5. Quelle est la durée usuelle de la procédure de sélection?
6. Questions complémentaires
6.1. Les tribunaux sont-ils considérés comme un employeur prestigieux ? Si non, existe-t-il des programmes destinés à accroître l’attractivité des tribunaux en tant qu’employeurs ?
6.2. Dans votre pays, le système judiciaire connaît-il une pénurie de candidats souhaitant intégrer :
6.2.1. le personnel judiciaire ?
6.2.2. le personnel administratif ?
6.3. Concernant le fonctionnement du système judiciaire, éprouvez-vous une pénurie de :
6.3.1. personnel judiciaire ?
6.3.2. personnel administratif ?
6.4. Quelle est votre impression personnelle sur la qualité et le nombre des candidats, en comparaison avec les années précédentes ?
6.5. Veuillez indiquer (« X ») de quelle manière les facteurs suivants influent, selon vous, sur l’attractivité du système judiciaire pour les personnes envisageant d’intégrer :
6.5.1. le personnel judiciaire :
Très négatif
Plutôt négatif
Neutre
Plutôt positif
Très positif
Avantages
Prestige
Progression professionnelle
Rémunération
Procédure de sélection
Obligations particulières
6.5.2. le personnel administratif :
Très négatif
Plutôt négatif
Neutre
Plutôt positif
Très positif
Avantages
Prestige
Progression professionnelle
Rémunération
Procédure de sélection
Obligations particulières
NETWORK OF THE PRESIDENTS OF THE SUPREME JUDICIAL COURTS
OF THE EUROPEAN UNION
CONFERENCE OF THE NETWORK
3–4 OCTOBER 2024
ATHENS, GREECE
“Attractiveness of the Judiciary”
QUESTIONNAIRE
Established by
Mr Petr Angyalossy
President of the Supreme Court of the Czech Republic
Ms Danguolė Bublienė
President of the Supreme Court of Lithuania
Mr Miodrag Đorđević
President of the Supreme Court of Slovenia
PART II
ATTRACTIVENESS OF THE JUDICIARY TO COURT PERSONNEL
For the purpose of this questionnaire:
• Judicial staff are defined as the expert qualified staff contributing to the judicial proceedings/involved in the decision-making (e.g. assistant judges, assistants to judges, advisers, consultants, Rechtspfleger, référendaires).
• Administrative staff are defined as staff not involved in decision-making and includes the positions of accountant, court reporter (stenographer), human resources clerk, IT specialist, and registry clerk.
• “Court personnel” includes both of the above categories.
1. General questions
1.1. How many assistants/other judicial staff does one judge have (both in practice and according to the number of positions formally approved):
1.1.1. in the court of first instance?
1.1.2. in the Supreme Court?
1.2. How many judges and how many assistant judges and other judicial staff are there in the Supreme Court (both in practice and according to the number of positions formally approved)?
1.3. What is the distribution of judicial staff by age and gender?
2. Remuneration
2.1. In your country, how do you determine the salaries of:
2.1.1. judicial staff?
2.1.2. administrative staff?
2.1.3. Are the salaries of judicial staff linked in some way to the salaries of judges?
2.2. Does the determination differ based on court instances?
2.3. Please state the starting gross salary and salary after 10 years of the judicial staff (reflecting your national organization) in:
2.3.1. first instance courts
2.3.2. Supreme Court.
2.4. Please state the starting gross salary and salary after 10 years of the following administrative staff in the courts:
Starting salary
Salary after 10 years
Accountant
Court reporter (stenographer)
Human resources clerk
IT specialist
Registry clerk
2.5. Is there a difference in the determination of remuneration of court personnel and other state employees?
2.6. What is the ratio between the starting salary of:
2.6.1. first instance judicial staff and the average salary in your country?
2.6.2. Supreme court judicial staff and the average salary in your country?
2.6.3. first instance administrative staff and the average salary in your country?
2.6.4. Supreme court administrative staff and the average salary in your country?
2.7. Is there an ongoing public discussion concerning remuneration of court personnel?
3. Other Material and Non-Material Benefits
3.1. Please indicate (“X”) whether any of the following (non-)material benefits are available for court personnel:
First instance judicial staff
Supreme Court judicial staff
First instance administrative staff
Supreme Court administrative staff
Accommodation (e.g. apartment)
Accommodation allowance
Meal allowance
More than the legally prescribed number of vacation days
Sabbatical
Sick time (outside health insurance)
Study leave
Working from home
Additional contribution to pension savings
Financial contribution for cultural events (theatre, etc.)
Financial contribution for sports
Financial contribution to a vacation
Court cafeteria
Day care for children provided by the court
Telephone, laptop
Language courses
Other educational courses
Others (please specify):
3.2. Is there ongoing public discussion concerning these issues (e.g. scope of these benefits, their amount)? If yes, please specify.
4. Special Obligations
4.1. Are there any special obligations imposed on court personnel (e.g. confidentiality, prohibition of secondary activities)? Please specify.
5. Selection Procedure and Promotion
5.1. What requirements do candidates need to meet (e.g. degree in a specialized field, length of previous practice)? Please specify:
5.1.1. in the case of judicial staff
5.1.2. in the case of administrative staff.
5.2. What is the selection procedure for:
5.2.1. judicial staff?
5.2.2. administrative staff?
5.3. Does the selection procedure ensure diversity of:
5.3.1. Candidates?
5.3.2. court personnel?
5.4. Is being a member of the judicial staff a prerequisite or an advantage for becoming a judge? Please specify.
5.5. How long does the selection procedure usually take?
6. Summary Questions
6.1. Are the courts considered a prestigious employer? If not, are there any programmes to increase the attractiveness of the court as an employer?
6.2. Does the judiciary in your country experience a lack of candidates interested in becoming:
6.2.1. judicial staff?
6.2.2. administrative staff?
6.3. Regarding the functioning of the judiciary, are you experiencing a lack of:
6.3.1. judicial staff?
6.3.2. administrative staff?
6.4. What is your personal impression of the quality and number of candidates in comparison with previous years?
6.5. Please indicate (“X”) how the following factors, in your view, affect the attractiveness of the judiciary for those interested in becoming:
6.5.1. judicial staff:
Highly negative
Rather negative
Neutral
Rather positive
Highly positive
Benefits
Prestige
Professional growth
Remuneration
Selection procedure
Special obligations
6.5.2. administrative staff:
Highly negative
Rather negative
Neutral
Rather positive
Highly positive
Benefits
Prestige
Professional growth
Remuneration
Selection procedure
Special obligations